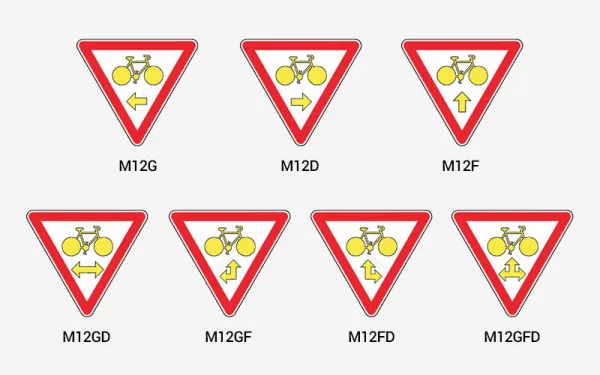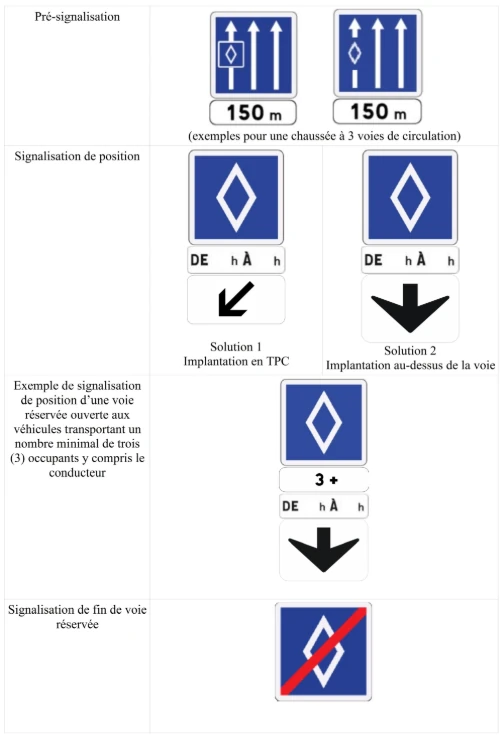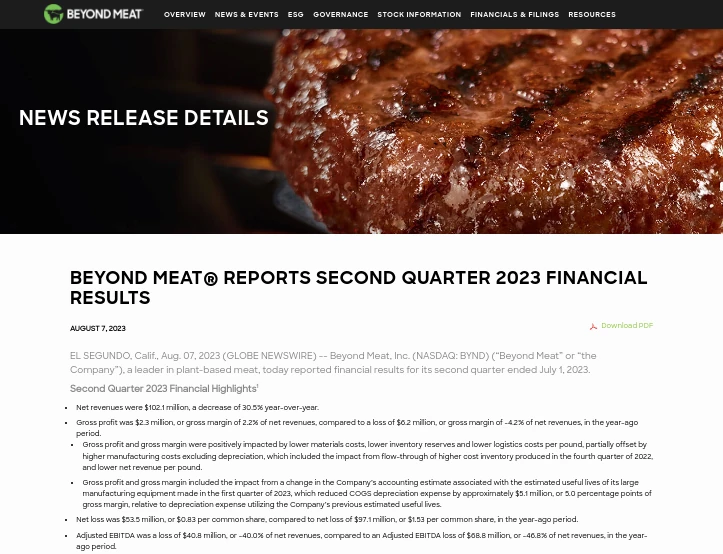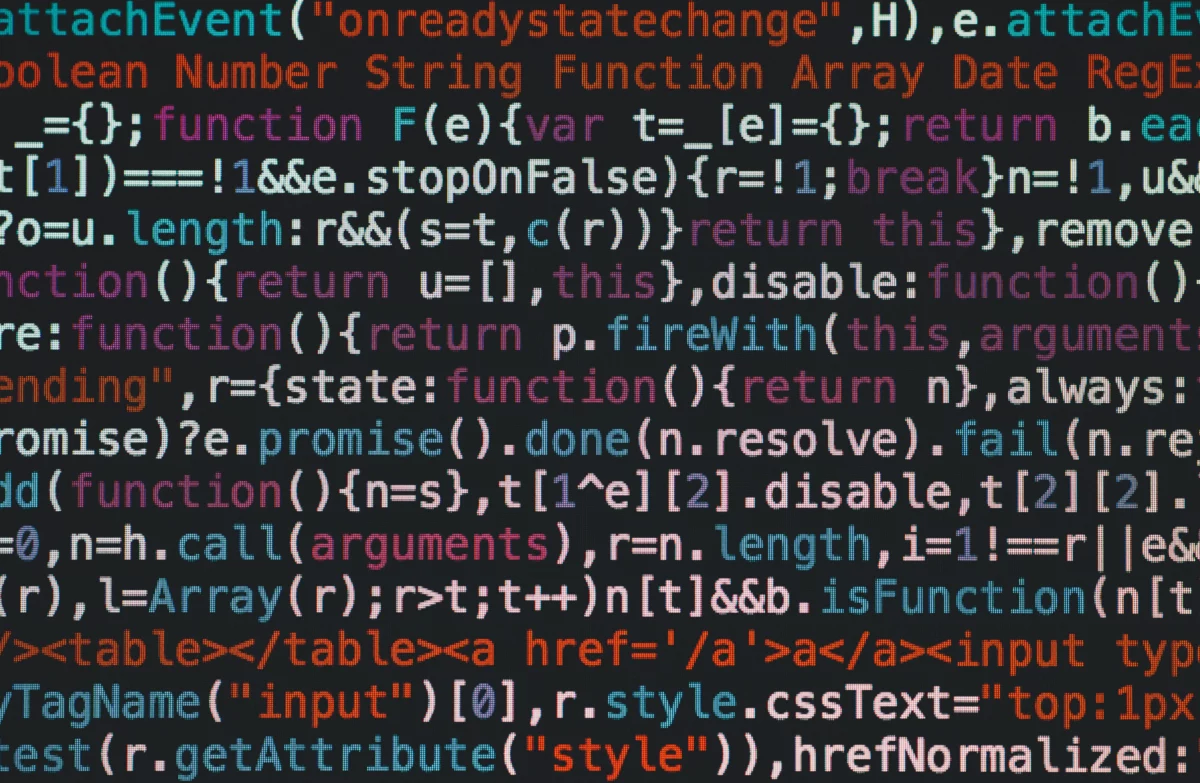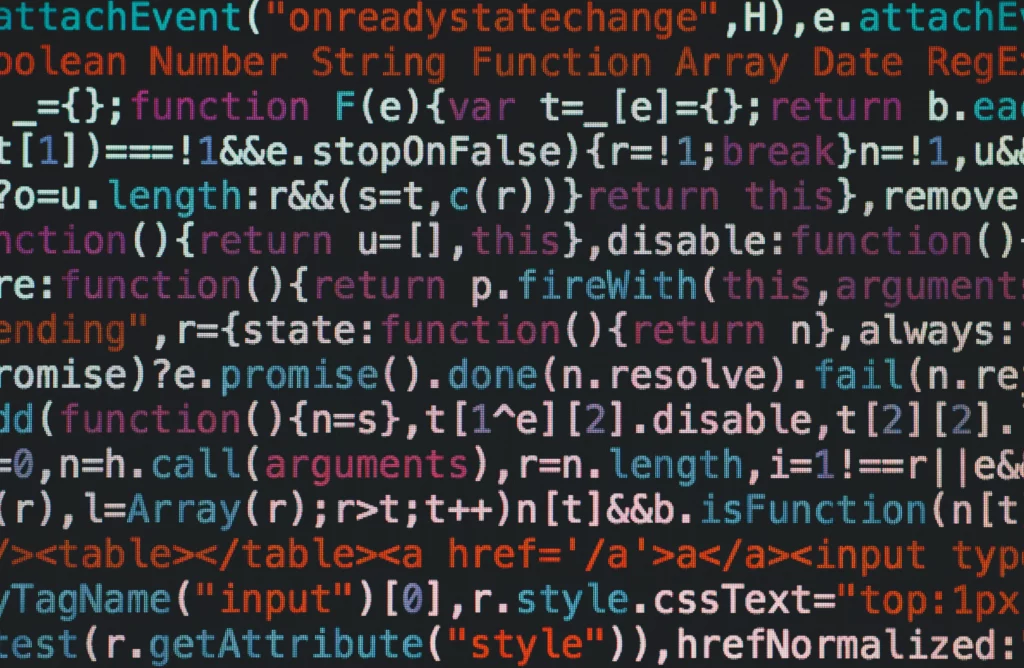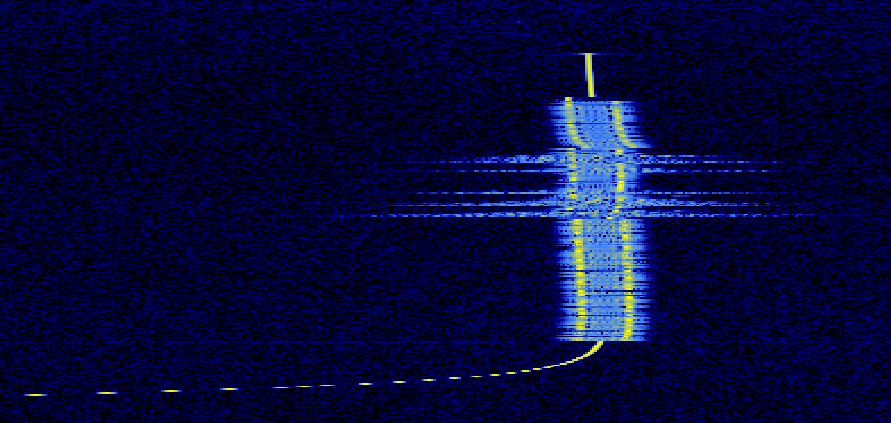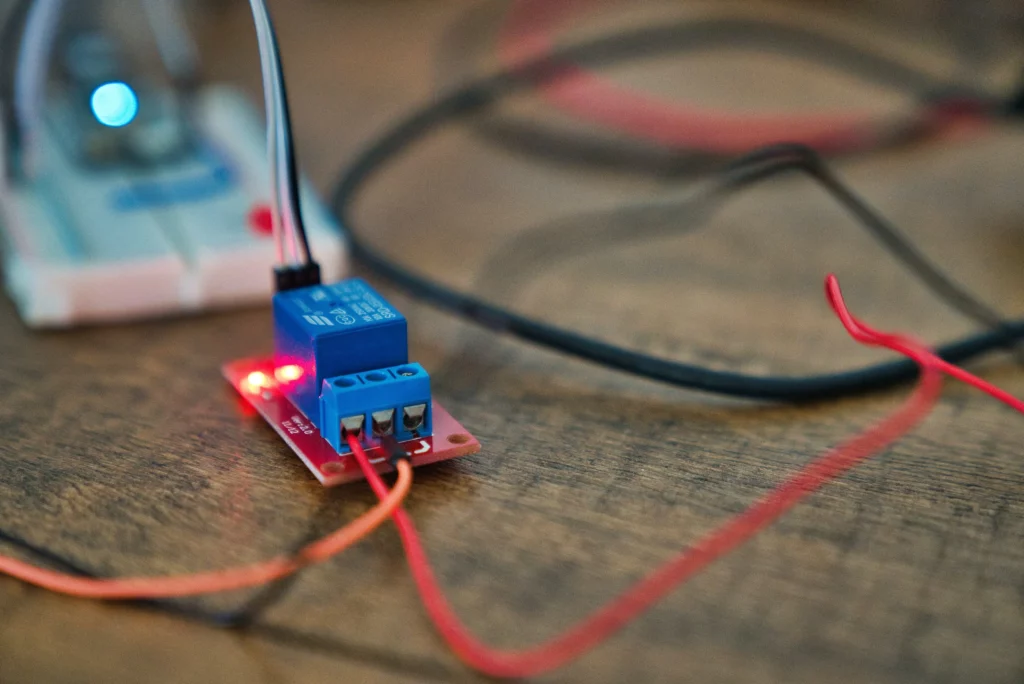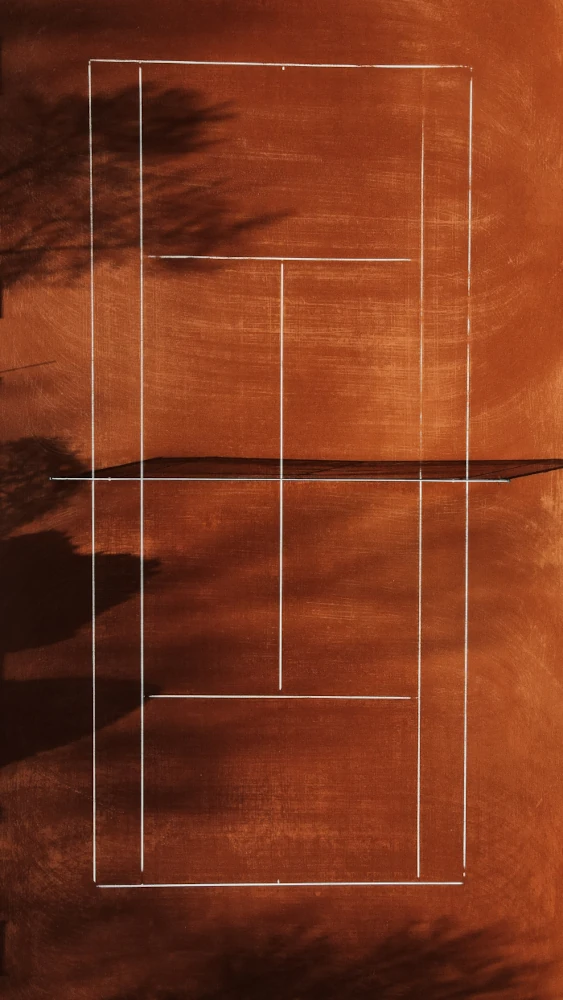Existe-t-il une société de consommation ou pas? Le capitalisme façonne-t-il la vie quotidienne des gens ou pas? Ce thème étant à nos yeux essentiel, il y a lieu de se pencher sur l’avis de Michel Clouscard. Ce penseur (1928-2009) a vu son activité passer inaperçue durant sa vie, à peu de choses près, mais depuis une dizaine d’années à peu près, il y a un courant de pensée qui en fait la promotion.
Michel Clouscard aurait le premier tout compris : le capitalisme est libéral-libertaire et exige un mode de vie « libéré » dont la seule liberté est de fuir dans la consommation. Mai 1968 aurait été le détonateur de ce capitalisme nouveau, qu’il appelle le « capitalisme de la séduction ».
Les philosophes issus de ce capitalisme nouveau auraient été les pires, parce qu’ils se prétendaient de gauche alors qu’ils faisaient la promotion d’un style de vie hédoniste. On parle ici des philosophes Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida.
Voici les grandes lignes, en apparence, de la pensée de Michel Clouscard, dont on se dit que c’est très intéressant pour effectivement dénoncer la généralisation du style de vie allant avec la société de consommation. Le souci est qu’il ne dit pas ça.
En effet, Michel Clouscard ne dénonce pas ce que nous appelons sur agauche.org le turbocapitalisme. Il ne dénonce pas du tout le renouveau du capitalisme, la naissance de nouveaux marchés au moyen de la négation des rapports naturels.
Michel Clouscard dénonce le maintien artificiel du capitalisme au moyen de micro-consommations « amusantes » qui trompent les gens fascinés (mais qui ne consomment pas).
Cela n’a rien à voir !
Tout le monde consomme-t-il ou non?
Si on regarde ce que dit la gauche de la gauche en 2023 au sujet des masses, on croirait que les travailleurs français sont pauvres jusqu’à pratiquement ne plus savoir comment payer leur loyer ou leur alimentation.
C’est évidemment complètement faux. Le niveau de vie est très élevé. La France est l’une des plus grandes puissances mondiales, même si elle est en chute libre. Tous les Français consomment. Certains consomment plus que d’autres, mais tous le font et tous relèvent de la société de consommation, même si à des degrés différents.
Tout propos misérabiliste est donc trompeur. Et Michel Clouscard y participe. Il est présenté comme un critique de la société de consommation. En réalité, il ne le fait pas car il ne reconnaît pas la société de consommation. Il critique un capitalisme qui cherche à établir une société de consommation de manière forcée, sans y arriver, ce qui est bien différent.
Michel Clouscard reconnaît tout à fait que le niveau de vie s’est élevé. Pour autant, il ne pense pas que le capitalisme se soit réellement élevé au niveau d’une vaste consommation de masse. Donc il ne dénonce pas la société de consommation telle qu’elle existe (selon nous) aujourd’hui. Il dénonce le fait que le capitalisme aimerait parvenir à une telle société de consommation (mais pour lui elle n’y arrive pas).
Pas de capitalisme par en bas?
L’idée de Michel Clouscard, c’est qu’il y a des couches sociales petites-bourgeoises qui profitent d’une manne capitaliste afin de mener une consommation « libidinale, ludique, marginale ». Cela produirait une agitation faisant vivre l’idéologie libérale-libertaire.
Mais cette agitation est « idéologique » plus qu’autre chose. D’ailleurs, pour Michel Clouscard, les monopoles domineraient tout et donc il ne peut pas y avoir de renouveau du capitalisme, de relance par en bas.
Autrement dit, Michel Clouscard ne dénonce pas la société de consommation, le capitalisme par en bas – car il ne le reconnaît pas.
Ce qu’il attaque, c’est l’existence de marges intellectuelles universitaires et d’aventuriers consommateurs « d’un nouveau style ». Michel Clouscard dénonce pour cette raison… le rock et la disco!
Déjà que c’est absurde car rien n’a été pratiquement plus populaire à l’échelle de masse que le rock et la disco dans les pays occidentaux, c’est surtout totalement réactionnaire. Mais Michel Clouscard est un philosophe du PCF d’après 1968, et le PCF a été contre Mai 1968. Le PCF, avec la CGT, a tout fait pour casser la contestation de Mai 1968.
Michel Clouscard est totalement aligné sur le PCF et sa théorie du « capitalisme de la séduction » se fonde d’ailleurs sur la théorie du capitalisme monopoliste d’État du PCF.
Le capitalisme monopoliste d’État
Michel Clouscard est un penseur du PCF et à son époque, il est totalement dans l’ombre de deux penseurs concurrents : Louis Althusser et Nikos Poulantzas. Ces deux derniers accordent une grande place à la question de l’État. Pour cette raison, ils penchent sérieusement du côté des « gauchistes », puisque eux veulent détruire l’État.
Michel Clouscard, lui, est totalement anti-gauchiste et il l’est, car il est d’accord avec le PCF : l’État est une forme neutre. Prétendre le contraire, selon lui, c’est faire du « marxisme dogmatique ». Pour Michel Clouscard, il y aurait une « société civile ».
On l’a compris : il reprend directement Antonio Gramsci, avec la même interprétation électoraliste que le Parti communiste italien à l’époque. Dans cet esprit, l’État peut pencher d’un côté, il peut pencher de l’autre.
Lorsqu’il écrit son ouvrage « La Bête sauvage, Métamorphose de la société capitaliste et stratégie » (1983), Michel Clouscard le fait après le programme commun et en assumant totalement la thèse du PCF du « capitalisme monopoliste d’État ».
Cette conception veut que l’État est devenu neutre, car avec la seconde guerre mondiale, l’impérialisme a disparu. Le capitalisme n’existe plus que par les aides de l’État. Il suffit donc de conquérir les commandes de l’État, au moyen d’une union populaire pour « autogérer » l’État, et alors on pourra prendre des mesures pour se débarrasser du capitalisme.
Cette théorie du « capitalisme monopoliste d’Etat » a été conceptualisée par le Français Paul Boccara en s’inspirant du Hongrois Eugen Varga.
Par conséquent, pour Michel Clouscard, tous ceux qui veulent dénoncer l’État par la révolution… sont en fait au service des monopoles qui veulent empêcher le PCF de prendre le contrôle de l’État par les élections et de le donner au peuple !
« Avec le Capitalisme Monopoliste d’État, l’État est totalement investi par l’économique, par les monopoles qui se sont étatisés et sont gérés par l’appareil d’État. Alors cet appareil d’État se moque de l’État croquemitaine du dogmatisme, du gauchisme, des nouveaux philosophes, des contestataires ou des terroristes.
Bien au contraire : sa mission économique est de créer les conditions superstructurales nécessaires à l’expansion économique du Capitalisme Monopoliste d’État.
Il faut mettre en place les modèles culturels de la nouvelle consommation, du nouveau marché du désir. Il faut libéraliser, révolutionner les mœurs. Pour servir au mieux les intérêts des multinationales que l’appareil d’État a fonction de gérer.
Parce que répressif au niveau de la production – productivisme, taylorisation, fordisme, cadences infernales – l’État doit organiser la libéralisation des mœurs qui permettra la meilleure circulation de la nouvelle marchandise.
L’État a besoin d’une société civile qui dénonce… l’État. Aussi, le dogmatisme, le gauchisme, les nouveaux philosophes sont les fourriers de la société civile voulue par l’appareil d’État soumis aux multinationales. »
Comme on le voit, Michel Clouscard ne dénonce pas le capitalisme en mode turbo, il ne dénonce pas le capitalisme qui se renouvelle. Pour lui, il n’y a qu’un seul capitalisme, un très gros capitalisme, qui « pense » et qui façonne la société civile.
C’est la conception réformiste et fantasmatique d’un capitalisme qui « pense », qui fait des « choix », par en haut.
Michel Clouscard n’est pas un critique du capitalisme se relançant par en bas !
Que dénonce Michel Clouscard ?
Michel Clouscard ne critique pas le capitalisme par en bas, qui pour lui ne peut pas exister. Il dénonce le gros capitalisme qui, dans ses soucis de modernité, bouscule le pays, le violente.
Si l’on veut, il ne critique pas les bobos, les start up, les influenceurs, les kebabs, mais la généralisation de la fibre et des voies pour vélos.
C’est caricaturé et pourtant cela correspond au fond de sa pensée. Voici un exemple avec sa défense du paysage français « idyllique » que le capitalisme viendrait défigurer :
« Le capitalisme monopoliste d’État a totalement détruit l’harmonie spatio-temporelle inventée par l’histoire de France (celle de ses modes de production).
Si les écologistes étaient sérieux, ils ne diraient pas vouloir protéger la nature, mais le travail de l’homme objectivé, devenu nature, décor naturel : campagne humanisée, forêt jardinée, déserts ou marécages cultivés, montagnes recouvertes d’arbres, fleuves domestiqués, etc.
« Oui au cantonnier, non à l’écologisme mondain. »
Pour substituer au rythme rural le productivisme généralisé, le capitalisme monopoliste d’État a désintégré la cellule familiale.
C’est le lieu de l’emploi et non plus le lieu d’origine qui fixe la famille, maintenant. Une extraordinaire diaspora des régions recouvre l’hexagone. »
C’est littéralement l’idéologie de Pétain, du retour à la terre. Comme si la France d’avant les monopoles, c’était le paradis ! Mais Michel Clouscard ne fait que ça, insulter ce qui est nouveau. Il n’hésite pas à considérer comme odieux que des gens, dans les années 1980, connaissent le reggae, mais pas le twist.
Ce qu’il dénonce, c’est la modernité, forcément unilatéralement mauvaise. Le capitalisme ne fabrique plus que des « gadgets » pour lui, et encore même pas pour tout le monde.
Et les rares cas où il le fait, c’est vide de sens pour lui : mettre une pièce dans un flipper, dans un juke-box, pour acheter un poster… Même le blue jean ou avoir les cheveux longs pour un garçon n’échappe pas à la critique, réactionnaire, de Michel Clouscard.
Citons sa dénonciation de la danse, incroyablement réactionnaire et délirante dans son propos même : on sent le vieux, dépassé et prompt à l’outrance.
« L’autre animation : sonore. L’autre machination : boîte à rythme, cabine leslie, pédale wah-wah, synthétiseur, fender, guitare électrique, etc.
L’autre initiation à la mondanité : psychédélique. Après la mécanique de groupe, voici la mécanique « musicale ». Branchons la sono. Le disc-jockey ouvre les vannes.
La statue accède au rythme. L’automate au déhanchement. Le désir à sa forme : les sens s’électrisent. Le mannequin s’anime de pulsions : gestes saccadés, répétés, figés. Bruitages de ces élans machinaux. Projection et transferts.
Vie de machine, corps du désir, corps rythmé. Le désir s’est éveillé. La statue est vivante : le machinal est son instinct (le vitalisme n’est que le reflet actif du mécanisme. Il n’est qu’un signifiant de l’animation machinale). L’être est gestuel. Et celui-ci est le rythme. »
Ces lignes de son ouvrage « Le capitalisme de la séduction » auraient été crétines en 1970, mais elles datent de 1981… que dire ? Un peu après ces lignes, on a même la définition du rock comme « Boum-boum : c’est toujours pareil ». En 1981 ! Après les Doors, le Grateful dead, Pink Floyd, Yes…
Le capitalisme zombie
Ce que dénonce en fait Michel Clouscard, c’est la modernité dans le cadre capitaliste. Et pour lui, elle ne peut qu’être entièrement fausse.
Car pour lui tout ne peux qu’être faux. Michel Clouscard considère que le capitalisme a déjà « disparu », conformément à la thèse du capitalisme monopoliste d’État. C’est un capitalisme zombie qui n’existe que parce que l’État le maintient en perfusion. Il est donc « faux ». Et tout ce qu’il fait est faux.
C’est ce côté réactionnaire qui a amené Alain Soral a se rapprocher de Michel Clouscard, et a écrire la préface de son ouvrage Néo-fascisme et idéologie du désir : Genèse du libéralisme libertaire. Michel Clouscard a ensuite dénoncé Alain Soral, et pourtant ce dernier représente indéniablement la substance de sa critique de la modernité « monopolistique – libertaire ». Il a simplement ajouté l’antisémitisme et la dénonciation d’un « complot » de l’élite mondiale, afin de faire tenir un édifice sinon sans fondations aucune.
Alain Soral résume d’ailleurs le mieux la thèse de Michel Clouscard, en soulignant que le capitalisme ne propose pas une vraie consommation nouvelle, mais un simulacre de consommation :
« Je reprends la thèse du trop méconnu Michel Clouscard dont j’avais préfacé « Néo-fascisme et idéologie du désir »; la voici : après guerre, les capitalistes marchands, pour étendre le marché fatalement saturé de l’utilitaire, ont eu l’intelligence de lancer, en surfant sur le vent de liberté venu d’Amérique, le « marché du désir ».
Un marché de l’inutile dont le mécanisme fonctionne comme suit : un, réduire la liberté au désir, deux, réduire le désir à l’acte d’achat. »
La consommation simulacre
Pour parler en termes marxistes, on peut dire qu’agauche.org affirme qu’il y a des marchandises partout, partout. C’est une surproduction de marchandises.
La production de masse, c’est bien ! Mais consommer n’importe comment, n’importe quoi, c’est mal !
Life deluxe for all, c’est bien ! Mais les délires ultra-individualistes de type de l’idéologie LGBT, c’est mal !
Le capitalisme a élargi les forces productives, maintenant on récupère le tout et on change de direction. Et il ne faut pas laisser faire le capitalisme qui veut élargir les marchés en dénaturant l’humanité.
Il y a le bon nouveau et le mauvais nouveau !
Pour Michel Clouscard, dans la lignée du capitalisme monopoliste d’État, il n’y a pas trop de marchandises, il y a trop de capital, il y a surproduction de capital, l’expression exacte correspondant à ce concept est la « suraccumulation de capital« .
Le capital « invente » donc des moyens pour investir, pour forcer à une consommation… Quitte à brûler cette consommation et ce capital. Pour Michael Clouscard, les nouvelles marchandises sont des simulacres : une chaîne hi-fi, une guitare électrique, un appareil photo ?
Tout cela ne sert à rien, c’est « ludique, libidinal, marginal », on a l’accordéon, ça suffit bien !
Autrement dit, pour Michel Clouscard, le capitalisme se résume à Kim Kardashian et à la téléréalité. Il accorde une valeur suprême à des consommations « stériles » totalement insignifiantes en comparaison avec l’avalanche de marchandises que produit toujours davantage le capitalisme.
En ce sens, il ne sert à rien pour critiquer la société de consommation. Il ne voit pas qu’en plus des monopoles, il y a à la base un petit capitalisme hyper actif se renouvelant. C’est la conséquence de son acceptation de la thèse du « capitalisme monopoliste d’État », qui prétend qu’il n’y aurait plus que des monopoles qui domineraient tout. Il « oublie » concrètement qui produit les contenus pour Amazon, Etsy, Netflix, Apple…
Non, la consommation dans la société de consommation n’est pas du simulacre. Elle est liée à une production réelle de marchandises. Et on s’y noie plus qu’autre chose !