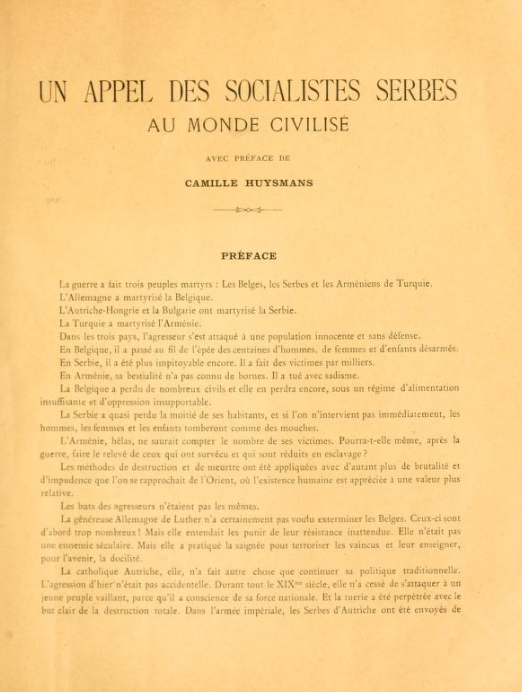C’était la première guerre mondiale.

La guerre est une horreur tout à fait concrète, épuisant les hommes au plus profond du corps et de l’esprit. Quand elle ne tue pas. C’est ce que raconte avec puissance le fameux roman À l’Ouest, rien de nouveau (Im Westen nichts Neues en allemand), publié par Erich Maria Remarque en 1929.
En voici les premières lignes, racontant la vie d’une poignée d’hommes au front. Ils sont les rares survivants d’une compagnie de 150 personnes et se retrouvent alors très content d’avoir une immense ration de nourriture et de tabac à se partager.
Il faut lire ce livre, ainsi que voir le film éponyme sorti l’année suivante en 1930, car la guerre mondiale est à nouveau d’actualité le 11 novembre 2022, l’Humanité n’ayant toujours pas compris la leçon.
« À L’OUEST RIEN DE NOUVEAU«
1
Nous sommes à neuf kilomètres en arrière du front. On nous a relevés hier. Maintenant, nous avons le ventre plein de haricots blancs avec de la viande de bœuf et nous sommes rassasiés et contents. Même, chacun a pu encore remplir sa gamelle pour ce soir ; il y a en outre double portion de saucisse et de pain : c’est une affaire ! Pareille chose ne nous est pas arrivée depuis longtemps ; le cuistot, avec sa rouge tête de tomate, va jusqu’à nous offrir lui-même ses vivres. À chaque passant il fait signe avec sa cuiller et lui donne une bonne tapée de nourriture. Il est tout désespéré parce qu’il ne sait pas comment il pourra vider à fond son « canon à rata ». Tjaden et Müller ont déniché des cuvettes et ils s’en sont fait mettre jusqu’aux bords, comme réserve. Tjaden agit ainsi par boulimie, Müller par prévoyance. Où Tjaden fourre tout cela, c’est une énigme pour tout le monde : il est et reste plat comme un hareng maigre.
Mais le plus fameux, c’est qu’il y a eu aussi double ration de tabac. Pour chacun, dix cigares, vingt cigarettes et deux carottes à chiquer : c’est très raisonnable. J’ai troqué avec Katczinsky mon tabac à chiquer pour ses cigarettes, cela m’en fait quarante. Ça suffira bien pour une journée.
À vrai dire, toute cette distribution ne nous était pas destinée. Les Prussiens ne sont pas si généreux que ça. Nous la devons simplement à une erreur.
Il y a quinze jours, nous montâmes en première ligne pour relever les camarades. Notre secteur était assez calme, et par conséquent le fourrier avait reçu, pour le jour de notre retour, la quantité normale de vivres et il avait préparé tout ce qu’il fallait pour les cent cinquante hommes de la compagnie. Or, précisément, le dernier jour il y eut, chez nous, un marmitage exceptionnel ; l’artillerie lourde anglaise pilonnait sans arrêt notre position, de sorte que nous eûmes de fortes pertes et que nous ne revînmes que quatre-vingts.
Nous étions rentrés de nuit et nous avions fait aussitôt notre trou, pour pouvoir, enfin, une bonne fois, dormir convenablement ; car Katczinsky a raison, la guerre ne serait pas trop insupportable si seulement on pouvait dormir davantage. Le sommeil qu’on prend en première ligne ne compte pas et quinze jours chaque fois c’est long.
Il était déjà midi lorsque les premiers d’entre nous se glissèrent hors des baraquements. Une demi-heure plus tard chacun avait pris sa gamelle et nous nous groupâmes devant la « Marie-rata », à l’odeur grasse et nourrissante. En tête, naturellement, étaient les plus affamés : le petit Albert Kropp, qui, de nous tous, a les idées les plus claires, et c’est pour cela qu’il est déjà soldat de première classe ; Müller, numéro cinq, qui traîne encore avec lui des livres de classe et rêve d’un examen de repêchage (au milieu d’un bombardement il pioche des théorèmes de physique) ; Leer, qui porte toute sa barbe et qui a une grande prédilection pour les filles des bordels d’officiers ; il affirme sous serment qu’elles sont obligées, par ordre du commandement, de porter des chemises de soie et, pour les visiteurs à partir de capitaine, de prendre un bain préalable ; le quatrième, c’est moi, Paul Baümer. Tous quatre âgés de dix-neuf ans, tous quatre sortis de la même classe pour aller à la guerre.
Tout derrière nous, nos amis. Tjaden, maigre serrurier, du même âge que nous, le plus grand bouffeur de la compagnie. Il s’assied pour manger, mince comme une allumette et il se relève gros comme une punaise enceinte ; Haie Westhus, dix-neuf ans aussi, ouvrier tourbier, qui peut facilement prendre dans sa main un pain de munition et dire : « Devinez ce que je tiens là » ; Detering, paysan qui ne pense qu’à sa ferme et à sa femme ; et, enfin, Stanislas Katczinsky, la tête de notre groupe, dur, rusé, roublard, âgé de quarante ans, avec un visage terreux, des yeux bleus, des épaules tombantes et un flair merveilleux pour découvrir le danger, la bonne nourriture et de beaux endroits où s’embusquer.
Notre groupe formait la tête du serpent qui se déroulait devant le canon à rata. Nous nous impatientions, car le cuistot était encore là immobile et attendait ingénument.
Enfin, Katczinsky lui cria :
« Allons, ouvre ta cave à bouillon, Henri ; on voit pourtant que les fayots sont cuits ! »
L’autre secoua la tête d’un air endormi :
« Il faut d’abord que tout le monde soit là. »
Tjaden ricana :
« Nous sommes tous là. »
Le caporal cuisinier ne s’était encore aperçu de rien.
« Oui, vous ne demanderiez pas mieux. Où sont donc les autres ?
— Ce n’est pas toi qui les nourriras aujourd’hui ! Ambulance et fosse commune. »
Le cuistot fut comme assommé lorsqu’il apprit les faits. Il chancela.
« Et moi qui ai cuisiné pour cent cinquante hommes ! »
Kropp lui donna une bourrade :
« Eh bien, pour une fois, nous mangerons à notre faim. Allons, commence ! »
Mais, soudain, Tjaden eut une illumination. Sa figure pointue de souris prit un teint luisant : ses yeux se rapetissèrent de malice, ses joues tressaillirent et il s’approcha le plus qu’il put :
« Mais alors… mon vieux !… tu as reçu aussi du pain pour cent cinquante hommes, hein ? »
Le caporal, encore estomaqué et l’esprit ailleurs, fit un signe de tête affirmatif.
Tjaden le saisit par la veste.
« Et aussi de la saucisse ? »
La tête de tomate fit oui de nouveau.
Les mâchoires de Tjaden tremblaient.
« Et aussi du tabac ?
— Oui, de tout. »
Tjaden regarda autour de lui, d’un air radieux.
« Nom de Dieu ! c’est ce qu’on appelle avoir de la veine ! Alors tout va être pour nous ! Chacun va recevoir… Attendez donc… ma foi oui, exactement double ration. »
Mais voici que la tomate revint à la vie et déclara :
« Non, ça ne va pas. »
Alors, nous aussi, nous nous éveillâmes et nous poussâmes en avant.
« Pourquoi donc que ça ne va pas, vieille carotte ? demanda Katczinsky.
— Ce qui est pour cent cinquante hommes ne peut pas être pour quatre-vingts.
— C’est ce que nous te ferons voir, grogna Müller.
— Le fricot, si vous voulez ; mais, les rations, je ne puis vous en donner que pour quatre-vingts », persista la tomate.
Katczinsky se fâcha.
« Tu veux te faire ramener à l’arrière, n’est-ce pas ?… Tu as de la bectance, non pas pour quatre-vingts hommes, mais pour la deuxième compagnie, suffit ! Tu vas nous la donner. La deuxième compagnie, c’est nous. »
Nous serrâmes de près le gaillard. Personne ne pouvait le souffrir : plusieurs fois déjà il avait été cause que dans la tranchée nous avions reçu la nourriture avec beaucoup de retard et toute froide, parce que, quand il y avait un peu de bombardement, il n’osait pas s’avancer suffisamment avec ses marmites, de sorte que nos camarades, en allant chercher le manger, avaient à faire un chemin beaucoup plus long que ceux des autres compagnies. Bulcke, de la première, par exemple, était un bien plus chic type. Il avait beau être gras comme une marmotte, lorsque c’était nécessaire, il traînait lui-même les plats jusqu’à la première ligne.
Nous étions précisément de l’humeur qu’il fallait et, à coup sûr, il y aurait eu de la casse, si notre commandant de compagnie ne s’était pas trouvé à venir. Il demanda la raison de la dispute et se contenta de dire :
« Oui, nous avons eu hier de fortes pertes…» Puis il regarda dans la chaudière.
« Les haricots ont l’air bon. » La tomate fit signe que oui.
« Cuits avec de la graisse et de la viande. »
Le lieutenant nous regarda. Il savait ce que nous pensions. Il savait aussi beaucoup d’autres choses, car il avait grandi parmi nous, et il n’était que caporal quand il était venu à la compagnie. Il souleva encore une fois le couvercle de la chaudière et renifla. En s’en allant il dit :
« Apportez-m’en aussi une pleine assiette. Et on distribuera toutes les rations : ça ne nous fera pas de mal. »
La tomate prit un air stupide, tandis que Tjaden dansait autour de lui.
« Ça ne te fait aucun tort, à toi. On dirait que les subsistances lui appartiennent ! Allons, commence, vieux fricoteur, et ne te trompe pas en comptant…
— Va te faire foutre ! » hurla la tomate.
Il était tout dérouté ; une pareille chose ne pouvait pas entrer dans son esprit ; il ne comprenait plus le monde où il se trouvait. Et, comme s’il eût voulu montrer que maintenant tout lui était égal, de son propre mouvement il distribua encore par tête une demi-livre de miel artificiel.
Aujourd’hui, c’est vraiment une bonne journée. Même le courrier est là ; presque tout le monde a reçu des lettres et des journaux. Maintenant nous déambulons vers le pré derrière les baraquements. Kropp a sous son bras le couvercle d’un fût de margarine. »