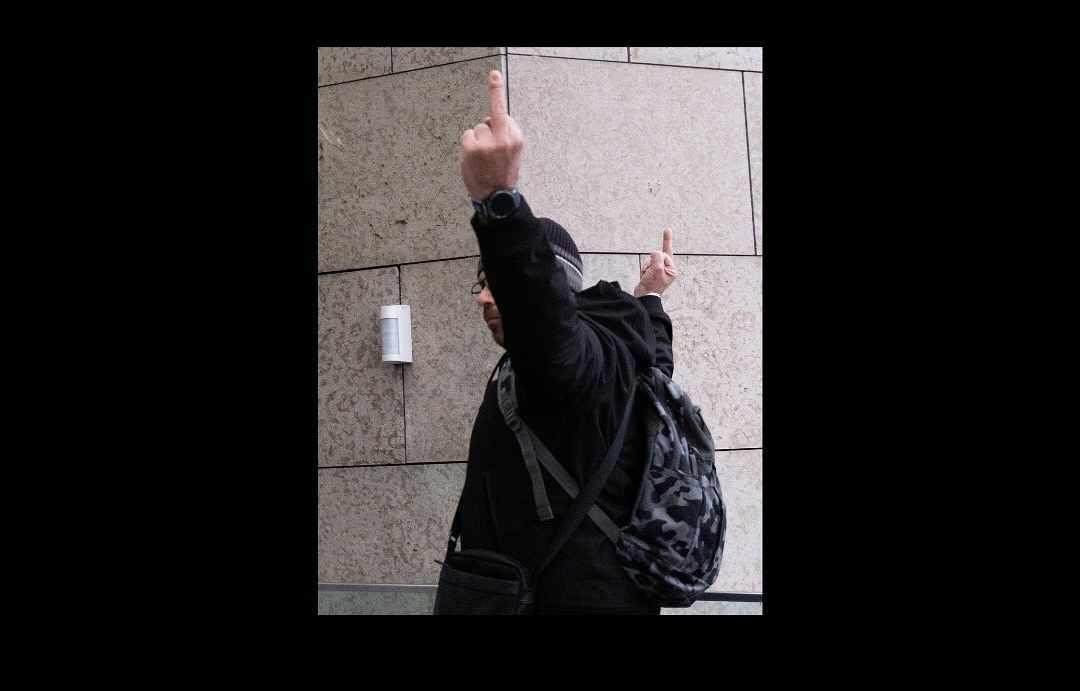Depuis la réunion du 20 mars 2025 entre les ministres de l’Économie, des Armées, de la Direction générale de l’armement et des principaux acteurs industriels et financiers de l’armement, le capitalisme français est entré dans la phase active de restructuration d’une partie de sa base industrielle pour garantir sa place dans la guerre de partage qui vient.
Le renforcement de la dictature des monopoles de l’armement va crescendo, dans le silence le plus complet de la classe ouvrière, et la complicité scandaleuse de la fausse Gauche. Les choses vont tellement vite que les capitalistes seront prêts pour se lancer ouvertement dans la guerre à l’horizon de 3-4 ans. Et il ne faudra pas venir s’en étonner !
Avec l’entreprise Europlasma est en train de se constituer un pilier de cette dictature des monopoles. Cette vaste entreprise spécialisée dans plusieurs secteurs intervient depuis plusieurs mois pour la reprise de sites industriels qualifiés de stratégiques pour la fabrication d’armes, principalement l’artillerie.

Au cœur de cette stratégie, il y a la création en décembre 2024 au sein de l’entreprise d’une sorte de filiale « pour faciliter le développement de ses activités de défense », baptisée « Lafayette Défense ».
Derrière cette stratégie, on retrouve la reprise, à chaque fois soutenue par l’Etat, de sites en difficultés tels que les Forges de Tarbes pour la production des corps creux d’obus, de l’entreprise Valdunes spécialisée dans la fabrication de roues ferroviaires et plus récemment de la Fonderie de Bretagne, anciennement détenue par le géant de l’automobile Renault. Aux Forges de Tarbes, les cadences de fabrication de corps creux d’obus sont déjà bien en cours d’augmentation.
Avec l’entreprise Valdunes qui compte deux sites de production, celui de Leffrinckoucke en périphérie de Dunkerque et celui de Trith-Saint-Léger près de Valenciennes, on a un belle illustration du fonctionnement des monopoles, se spécialisant alors dans l’armement.
Lorsque l’entreprise spécialisée dans l’activité ferroviaire a été reprise par Europlasma en mars 2024, il n’était pas question officiellement d’activité d’armement, avec un projet tourné surtout vers la « décarbonation ». Puis au courant du mois de mai 2024, Bizzell Corporation, un fabricant d’armes américain, entre au capital à hauteur de 25 %. Il est alors prévu de reconvertir le site de Leffrinckoucke vers la production de corps creux, avec la livraison de nouvelles machines dans ce sens pour le mois de juin 2025.
À la fin décembre 2024, répondant dans le journal La Voix du Nord aux inquiétudes, le PDG d’Europlasma Jérôme Garnache-Creuillot confirmait en des termes bien détournés, mais typiques de la bourgeoisie, de la reconversion vers l’armement :
« L’idée n’est pas de substituer une activité de défense à une activité ferroviaire, c’est de capitaliser sur le savoir-faire de l’activité ferroviaire pour déployer une activité de défense. Des gens qui savent forger, c’est très rare. »
Dans la même logique pleinement assumée, la « Fonderie de Bretagne » à Caudan, non loin de Lorient, initialement tournée vers la fabrication de pots d’échappement et de boites de vitesse peut être reprise par Europlasma dans le but de la réorienter vers la fabrication de corps creux pour obus.

Voilà qui est clair et qui démontre la reconversion d’une partie de la base industrielle française vers le secteur de l’armement sous l’égide de monopoles en lien avec l’Etat, agissant de manière anti-populaire et anti-démocratique. Il ne peut en être autrement pour le capitalisme en crise qui bascule dans la guerre pour le repartage mondial.
En parallèle au renforcement des monopoles de l’armement se constitue des forces financières pour venir en aide au besoin colossal de financement de ce secteur.
Dans ce cadre, il y a deux mois, la président de la région Occitanie issue de l’aile droite du P.S, Carole Delga, lançait un appel à faire financer les entreprises d’armement par les régions elles-mêmes.
Dans un communiqué daté du 25 mars 2025, la présidente de la région Occitanie appelait ainsi les régions à saisir les subventions européennes pour le financement de l’économie de guerre :
Face aux tensions géopolitiques croissantes et à l’incertitude du soutien américain, l’Europe doit prendre en main sa souveraineté et assurer seule sa sécurité. C’est le sens du plan « ReArm Europe », lancé par la Commission européenne, qui vise à garantir une autonomie stratégique essentielle pour préserver la paix sur notre continent. La France a un rôle central à jouer. Seule puissance à disposer de la dissuasion nucléaire dans l’UE et deuxième exportateur mondial d’armements, elle s’appuie sur une Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) robuste, qu’il est impératif de soutenir et de renforcer. Il est temps d’agir!
La région Occitanie a d’ores et déjà lancé le processus avec la création d’un nouveau fonds « défense et industrie » de 100 millions d’euros pour aider le développement des fabricants d’armes, un appel à manifestation d’intérêt de 50 millions d’euros pour financer des projets utiles au secteur, un programme de 2 millions d’euros orienté vers l’intelligence artificielle et la cybersécurité ainsi que 20 millions d’euros pour aider à la formation professionnelle.
C’est une restructuration profonde du capitalisme français qui se joue sous nos yeux. Ce n’est pas simplement une question de « militarisme », de poursuite de l’accumulation du capital sous la forme des débouchés militaires, mais bel et bien de la mise en place des conditions industrielles pour l’ouverture d’une nouvelle guerre de repartage.

La bourgeoisie n’en a évidemment pas conscience, elle gère ses affaires qui s’orientent comme naturellement dans ce sens. c’est l’ « économie de guerre » avec la reconversion de sites de production civile vers la production militaire, participant à orienter des investissements dans l’armement, exigeant à moyen-terme des retours sur investissements. C’est comme cela que se met en place l’emballement jusqu’à la déflagration générale, comme nous l’enseigne le précédent de 1914.
Pour contester cette tendance à la guerre, on ne peut évidemment pas compter sur les syndicats, arc-boutés sur le soutien aux « repreneurs » et vendant les ouvriers à l’impérialisme français, ce qui se retournera tôt ou tard contre eux.
Ni sur la fausse-gauche alignée sur le capitalisme avec son mot d’ordre des « nationalisations temporaires » des sites « stratégiques ». Difficile aussi de compter sur la gauche de la gauche et sa base petite-bourgeoise telle qu’elle s’est exprimée lors des manifestations du 1er mai, avec des slogans et des mots d’ordre qui partent dans tous les sens, mélangeant tout et n’importe quoi pour s’éviter d’assumer fermement une ligne opposée à la troisième guerre mondiale.
Ce qu’il faut cibler, c’est la restructuration du capitalisme français dans le cadre de la crise générale menant inéluctablement les peuples à un nouveau carnage injuste mené pour le seul compte des bourgeoisies.
Le seul mot d’ordre qui vaille, c’est : ou bien la révolution empêche la guerre, ou bien la guerre engendre la Révolution ! Et il faut y faire correspondre une mentalité, un style et une activité digne de ce mot d’ordre !