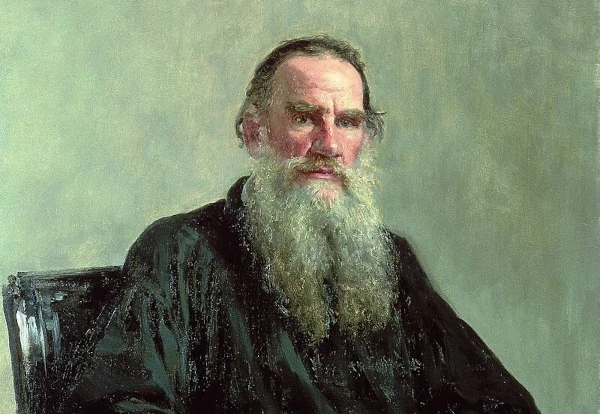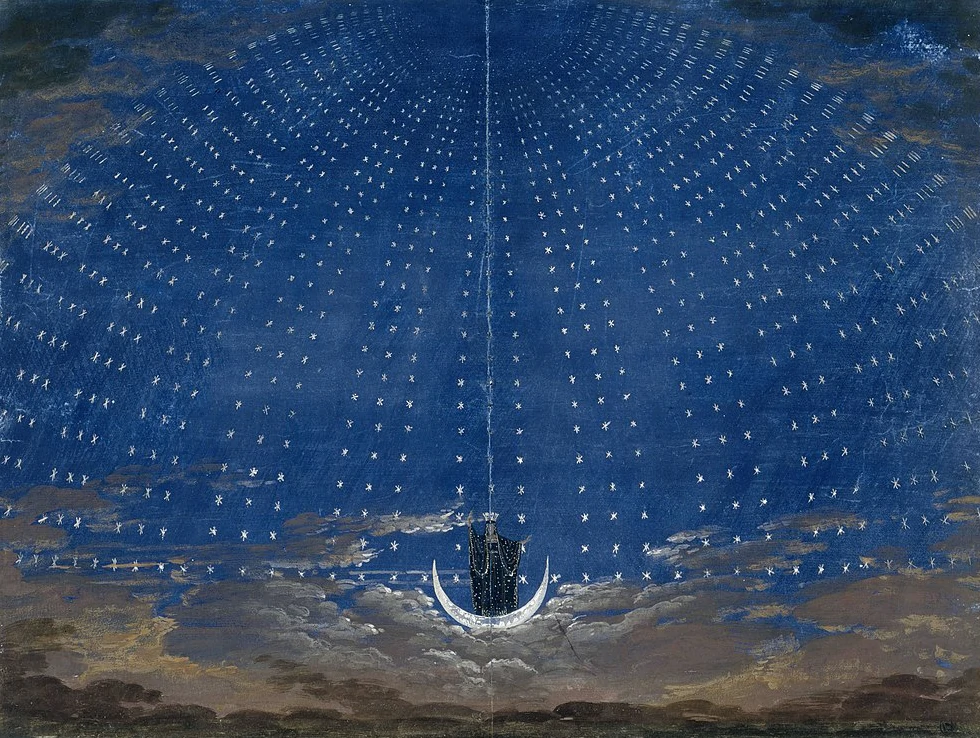Le 7 janvier 2015 est une date historique très importante de l’Histoire de France. Mais il serait profondément erroné de la résumer à un massacre commis par des islamistes dans les locaux du journal Charlie Hebdo.
Ce serait là leur reconnaître une forme de validité, alors qu’il n’y en a eu aucune. Ce qui a compté réellement, c’est l’expression française du rationalisme et de l’esprit critique, à travers « Je suis Charlie ».
« Je suis Charlie », ce fut, il y a dix ans, un mouvement d’écoeurement devant une action aussi barbare que déconnectée du réel. Car même si on n’aimait pas Charlie Hebdo, et si on considérait ses caricatures comme grossières, régressives, sans profondeur, sans esprit… on savait bien que ce n’était là qu’une forme déformée, excessive (et ainsi insignifiante) du rationalisme réel, du refus de l’hégémonie religieuse.
D’où un sentiment de compassion pour les victimes des tirs des islamistes. Les cinq dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski.
Mais également sur Frédéric Boisseau (un responsable des opérations de la société Sodexo chargée de la maintenance du bâtiment), la psychanalyste et chroniqueuse Elsa Cayat, l’économiste Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourrad.
Ainsi que sur le policier Franck Brinsolaro (qui assurait la protection de Charb et Michel Renaud),- et le gardien de la paix Ahmed Merabet.
Douze personnes assassinées, onze blessées, dont quatre grièvement, et par respect pour eux, les 10 et 11 janvier 2015, plus de quatre millions de personnes ont manifesté dans absolument tout le pays.

Il faut se souvenir de l’ambiance à ce moment-là. L’ensemble de la « gauche de la gauche » a dénoncé « Je suis Charlie » comme raciste ! Une position honteuse, stupide, fausse, écoeurante.
Car « Je suis Charlie » n’était simplement que l’expression de la mentalité française civilisée et libérale, rationaliste et hostile aux influences religieuses.
C’était petit-bourgeois et d’esprit fonctionnaire, c’est-à-dire somme toute « républicain ». Mais ce n’était certainement pas raciste. Et de toutes façons la question dépassait largement Charlie Hebdo, qu’on n’était nullement obligé d’apprécier, et d’ailleurs la majorité des Français n’ont jamais regardé que d’un air distrait voire hautain ce journal.
« Je suis Charlie », si on veut un équivalent, c’est le Front populaire de 1936, en France comme en Espagne, avec l’alliance des « républicains » et de la Gauche historique.
Le rapprochement est évident et la preuve que c’est vrai, c’est que la France de 2025, c’est le contraire de « Je suis Charlie ». Tant La France insoumise que le Rassemblement national ne sont pas du tout « Charlie ».
Quant aux partis politiques sérieux (la droite, le centre, la gauche), ils ne font même pas semblant de l’être, et déjà à l’époque ils avaient vite abandonné la prétention de l’être. Ils sont trop liés à la société capitaliste de consommation pour s’ennuyer avec la culture.
La France se trompe ainsi, et doit retourner pour une large partie à « Je suis Charlie ». Car « Je suis Charlie » portait une indéniable exigence de civilisation.
Et les gens qui viennent de cet arrière-plan intellectuel et culturel, même si petits-bourgeois, sont les alliés objectifs du Socialisme.
Car le rationalisme, la mise à l’écart des religions, l’exigence de civilisation… sont portés par le Socialisme désormais.