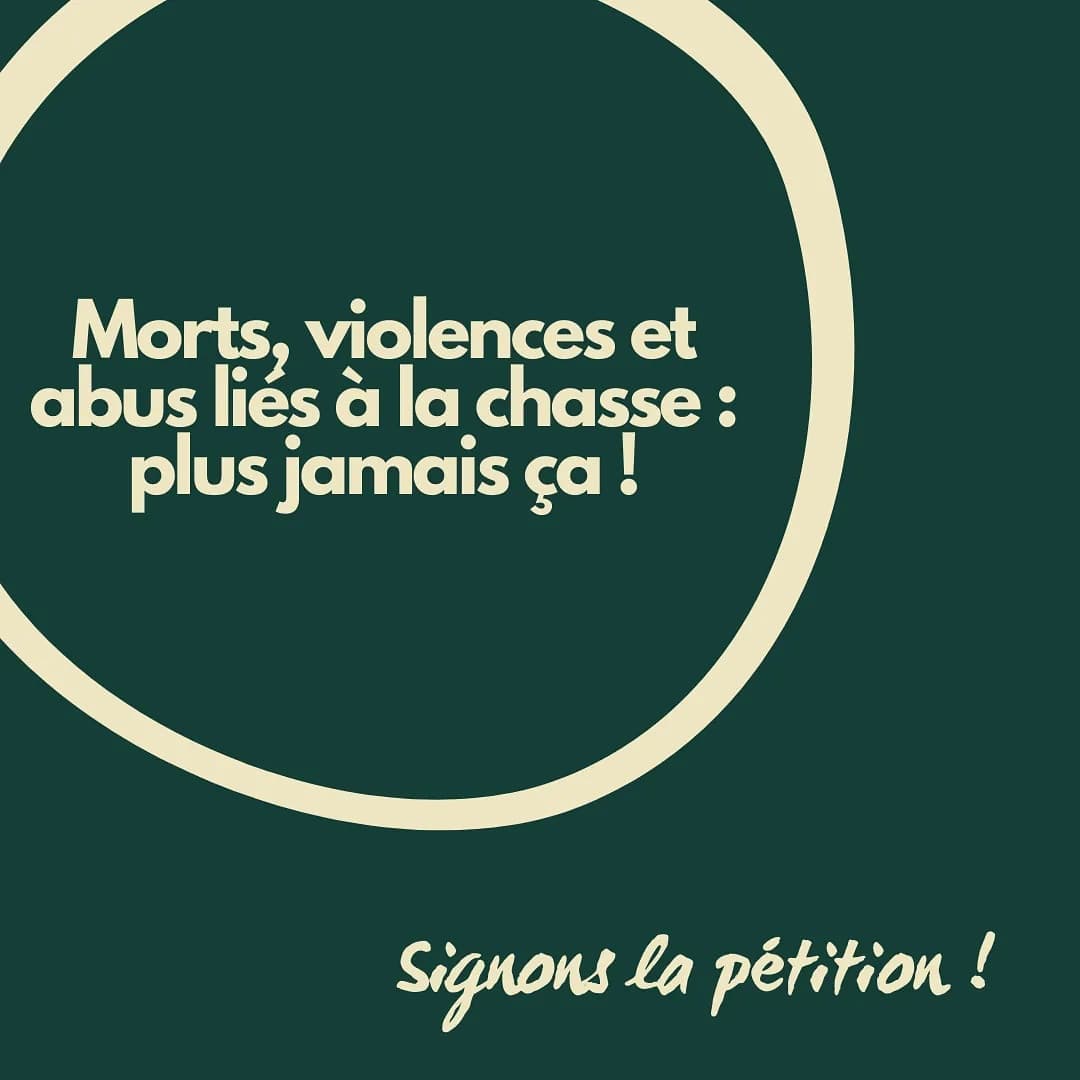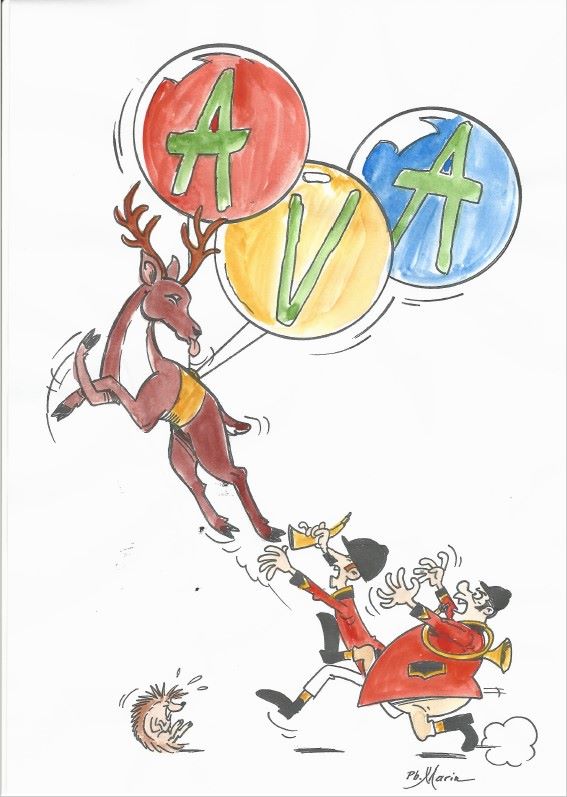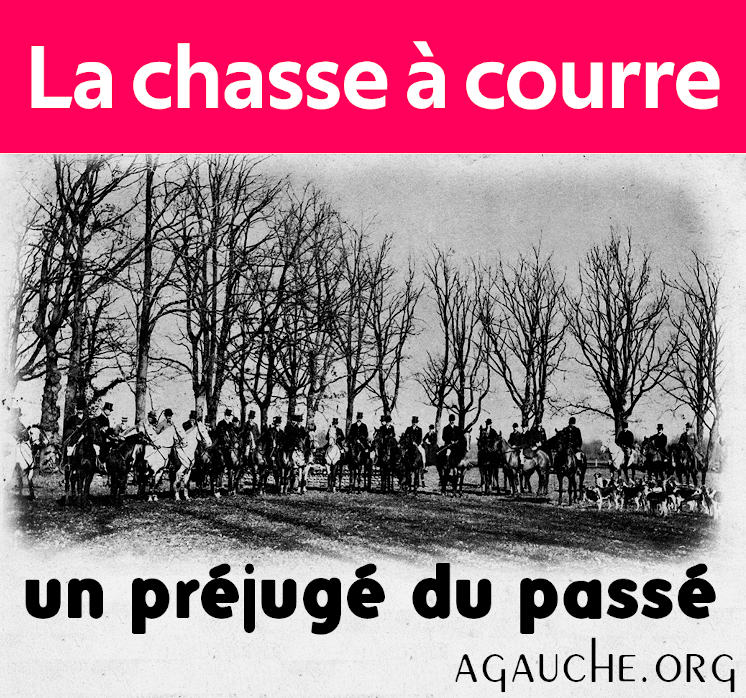Porter un regard intelligent sur le mouvement des agriculteurs français de janvier-février 2024, c’est se rappeler que les paysans ne sont pas une classe, et qu’il n’y a d’ailleurs plus de paysans en France. D’une masse fondamentalement petite-bourgeoise dans sa définition, les paysans sont devenus des agriculteurs, c’est-à-dire des petits-bourgeois entrepreneurs.
Le paysan possède, en effet, sa terre, et il veut accumuler ; c’est un propriétaire, même dans les cas où il est un petit propriétaire, même s’il est pauvre. C’est la raison pour laquelle l’URSS a mis en place tout un système pour « avaler » les paysans pauvres et moyens dans les collectivisme, par les fermes collectives (les kolkhozes) et les fermes d’État (les sovkhozes). Cela a été une bataille très dure, l’affrontement avec les paysans riches (les koulaks) est bien connu.

L’agriculteur est quant à lui un paysan qui a réussi, et dans le capitalisme du début du 21e siècle, cela en fait un capitaliste acharné, qui utilise notamment les animaux pour arracher du profit. Qui ne prend pas en compte les animaux tant sur le plan de la sensibilité que sur le plan de leur utilisation par le capitalisme ne peut pas comprendre notre époque. Le document Crise du capitalisme et intensification de la productivité : le rôle des animaux dans la chute tendancielle du taux de profit est ici fondamental.
Il n’y a donc rien à attendre des agriculteurs. Il faut faire avec, mais là encore ils sont les rois des bluffs. Il y a largement de quoi assez manger et leur prétention à dire qu’on va mourir de faim sans eux est juste risible. Ils font juste beaucoup de bruits pour se présenter comme incontournables.
Mais avec de l’organisation, une agriculture étatisée et planifiée est facile à mettre en place. Avec l’industrialisation et les technologies, c’est facile si on a les masses en mouvement. L’agriculture doit devenir une industrie, et les agriculteurs doivent céder la place aux ouvriers du 21e siècle. Le Socialisme n’a pas besoin d’eux et s’ils veulent travailler la terre, ils devront la faire dans une optique de service au peuple, pas d’aventurisme capitaliste aux dépens de la Nature.

Pour l’industrialisation du pays,
pour la collectivisation du village!
Le marteau et la faucille sont, il faut le rappeler, le symbole de l’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre. Il n’a jamais été question de faire de la petite-bourgeoisie des campagnes, propriétaire et entrepreneuse, une figure du Socialisme. Les paysans, c’est le petit capitalisme à fond, un puissant générateur de capitalisme, comme le montre l’histoire des États-Unis.
Lénine a dit un très bon mot à ce sujet :
« La petite production engendre le capitalisme et la bourgeoisie constamment, chaque jour, à chaque heure, d’une manière spontanée et dans de vastes proportions. »
S’imaginer, comme le fait « révolution permanente« , qu’il est possible de se tourner vers les agriculteurs et d’établir un programme « qui cherche à remettre en question le système agraire actuel qui est destiné à servir les grands capitalistes de l’agro-alimentaire, la grande distribution et les banques »… c’est ne rien comprendre justement aux agriculteurs, qui sont nés dans ce système, sont ce système et y tiennent dur comme fer.
D’ailleurs, les agriculteurs ne remettent jamais en cause le capitalisme et demande toujours à l’État de faire l’arbitre. Ils le font en correspondance avec leur nature sociale.

Au moins, la dirigeante des Écologistes Europe Écologie Les Verts Marine Tondelier l’a bien compris. Elle raconte qu’elle est fière de visiter les fermes et de discuter avec l’Interbev (l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), tout en étant vegan.
« Nous ne sommes pas les ennemis des agriculteurs », a déclaré la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, mercredi depuis une ferme de Bourgogne, où elle dit « soutenir totalement » les paysans dans leur combat pour un « juste revenu ». »Nous ne sommes pas les ennemis des agriculteurs », a déclaré la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, mercredi depuis une ferme de Bourgogne, où elle dit « soutenir totalement » les paysans dans leur combat pour un « juste revenu ».
« Je ne suis pas du tout mal aimée des agriculteurs », a assuré cette petite-fille de paysans du Pas-de-Calais, après avoir caressé des vaches bazadaises, une espèce menacée élevée dans une exploitation bio de Villebichot (Côte-d’Or), près de Dijon.
« J’ai même rencontré Interbev », l’association du bétail, « alors que je suis végane depuis 15 ans », a martelé Marine Tondelier. « Les fermes, c’est le type de déplacement que je fais le plus ! », a-t-elle ajouté. »
Voilà une soumission totale et ignoble, immorale et totalement opportuniste. Et c’est très vraisemblablement une vraie construction mythomane pour se soumettre ostensiblement, car elle n’a jamais auparavant dit qu’elle était vegan, mais végétarienne.
C’est un très bon exemple. Faut-il faire comme elle, considérer que les agriculteurs seront toujours là sous cette forme pendant encore cinquante ans? Ou bien faut-il révolutionner l’agriculture, car les temps sont mûrs pour un nouveau rapport avec la Nature?