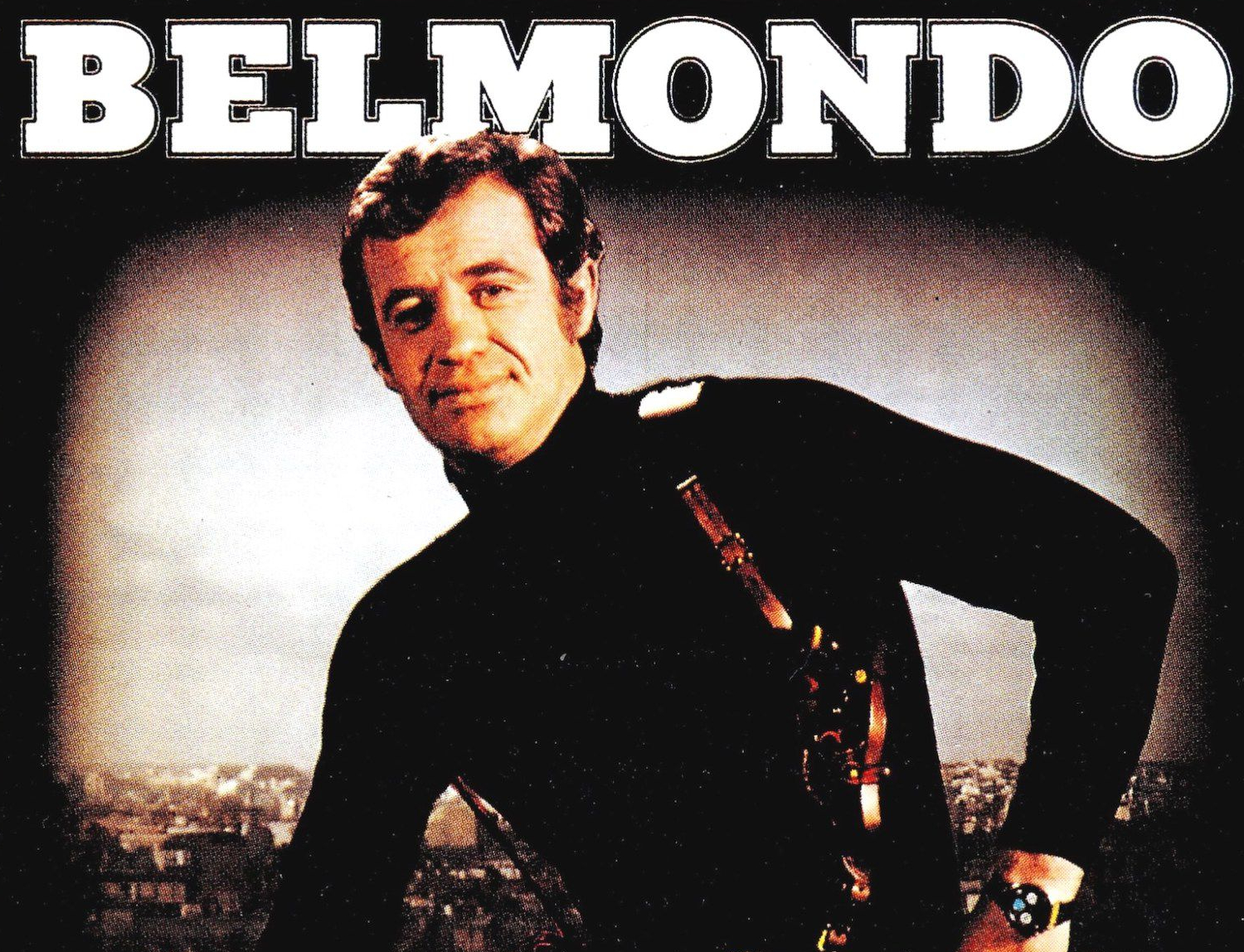Le film est désincarné et correspond à des critères commerciaux sans prise de risque.

Le film Dune, réalisé par le canadien Denis Villeneuve est récemment sorti au cinéma en France, rencontrant un important succès critique et réalisant plus de deux millions d’entrées.
Il s’agit du premier volet d’une adaptation du roman de Frank Herbert publié en 1965, qui comprendra des suites pour former le cycle de Dune.
On y suit principalement Paul, fils du duc de la Maison Atréides qui se voit confier la gestion de la planète Dune, une planète désertique où est récoltée une Épice précieuse, essentielle notamment au déplacement dans la galaxie en plus d’être une drogue aux multiples vertus.
Le contenu de ces deux sagas est en revanche totalement opposé.
Les premiers tomes de la trilogie originelle de Fondation dépeignent avant tout l’évolution déterministe d’une société , s’arrachant à l’histoire individuelle, avec des concepts passionnant comme celui de la psychohistoire.
Dune est une oeuvre ayant créé de son côté une vaste mythologie assez délirante, allant puiser de nombreux thèmes dans l’antiquité et la féodalité pour une dimension aristocratique, la religion notamment musulmane, ou encore le transhumanisme, avec une forte composante conspirationniste (l’ordre des Bene Gesserit) et dont le moteur de l’histoire se base sur un individu doté de don particulier, un messie.
On y trouve également l’influence des drogues et d’une vision les considérant comme permettant de s’ouvrir l’esprit, de faire fonctionner son imagination et de voir des choses impossibles sans. L’auteur Franck Herbert était lui même consommateur de champignons hallucinogènes.
Outre la réputation de l’oeuvre littéraire il y a également un culte autour de ses adaptations cinématographiques.
A la fin des années 1970 c’est le très psychédélique réalisateur et scénariste de bande dessinée Alejandro Jodorowsky qui travaille sur le projet avec des grands noms comme H. G. Giger, Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali ou encore Moebius. Malgré son abandon par le studio il existe encore une vraie fascination parmi les fans de Dune de ce qu’aurait pu être ce film (un documentaire est sorti à ce sujet il y a quelques années).
Quelques années plus tard, en 1984, une adaptation finit par sortir, celle de David Lynch, très critiquée à sa sortie pour son aspect kitsch, trop sec et pas assez fidèle pour les fans du roman, mais qui jouit malgré tout d’une petite aura culte encore aujourd’hui.
Presque 40 ans plus tard Dune a donc le droit à un nouveau film, par Denis Villeneuve, où il pousse encore plus loin son style déjà présent dans Blade Runner 2049.

Il y livre un film en efet totalement désincarné, dénué de toute substance, de toute profondeur, de vie.
Cela pourrait en partie coller pour une oeuvre comme Dune, se déroulant sur une planète désertique.
Mais l’intérêt devait justement venir du contraste, de la contradiction avec ce qu’il reste de la vie, qui tente de reprendre le dessus.
Et de contraste le film en manque à tous les niveaux, que ce soit au niveau du rythme, d’une triste monotonie en l’absence de toute dynamique, d’un rendu visuel avec une photographie très terne, quasiment monochrome, l’ensemble rappelant une esthétique publicitaire type parfumerie, ou même au niveau de la mise en scène qui applique les mêmes effets à toutes les scènes, rendant l’ensemble très plat, sans relief.
Et Denis Villeneuve semble même oublier en quoi consiste une adaptation cinématographique d’une oeuvre littéraire. Il livre une adaptation totalement terre à terre, n’apportant rien de ce que permet le medium cinéma.
Là où le roman accorde une place importante aux pensées de quelques personnages principaux, le film perd une grosse partie de la profondeur des personnages, qui n’est jamais contrebalancé par quoi que ce soit.
Car si le film, qui dure 2h30, prend son temps, il le prend simplement pour mettre en avant son esthétique épurée et vide, où il n’y a souvent pas de décor derrière les personnages, ou pour des ralentis stylisés qui n’apportent rien à la narration.
C’est donc un film lisse, une coquille vide bien triste et ainsi assez opposé à l’adaptation baroque de David Lynch, critiquable sur bien des points mais qui avait le mérite de tenter des choses, de prendre des risques et d’insuffler un peu de poésie à cet univers pour peu que l’on passe certains aspects qui faisaient déjà fauchés à l’époque alors que le budget de 45 millions de dollars était loin d’être négligeable alors.
Les deux films s’opposent également au niveau de leur partition musicale. Le film de Denis Villeneuve est accompagné de la musique de Hans Zimmer, un compositeur qui a révolutionné la manière de faire de la musique de film, notamment par sa société Remote Control où les musiques de film sont souvent écrites très rapidement, à plusieurs compositeurs, qui remâchent leur propre production, donnant l’impression d’entendre toujours la même chose, pas aidé par la grande pauvreté d’orchestration.
La musique n’est souvent plus alors une œuvre musicale qui fait corps avec la film, se servant mutuellement pour construire une ambiance et faire avancer le récit, elle n’est plus là que comme effet sonore, bruit de fond. Hollywood ayant peur que le spectateur s’ennuie il faut toujours remplir chaque scène.
Ce principe est assez bien illustré par le Dune de Denis Villeneuve où la musique est omniprésente, dans une sorte de mélange entre musique drone et world music où la seule fois où on peut apprécier son silence, c’est lors d’une scène d’action.
On est loin du score du Dune de Lynch, composé par le groupe Toto avec la participation de Brian Eno, avec ses thèmes servant la narration et la poésie du film. Et qui complète le très bon travail sur les effets sonores.
Là où le film de Denis Villeneuve est important, c’est qu’il s’agit d’une adaptation d’une franchise très populaire et attendue, par un réalisateur qui a depuis quelques films un nom connu et réputé.
Et pourtant Legendary Pictures, le studio qui produit le film, n’a donné son accord que pour une première partie de l’adaptation, la seconde dépend de son succès. Alors que la logique aurait voulu que les deux parties soient préparés et tournés comme un tout, comme l’a par exemple été la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson.
La frilosité, la peur de tout risque financier, se retrouve ainsi à tous les niveaux… Avec une production qui n’ose plus se lancer dans la nouveauté, mais recycle à l’infini les mêmes franchises… Avec une mise en scène où même un cinéaste réputé comme Denis Villeneuve livre un film terriblement fade où rien ne dépasse, avec ce qu’il faut de scènes spectaculaires et faciles.
Et jusque dans la musique, la “méthode Zimmer” ayant été assez largement adoptée dans les blockbusters hollywoodiens.

Mais au delà de l’aspect financier et profit que les studios peuvent tirer de tel ou tel films, c’est aussi le symbole d’un terrible manque de créativité.
Même en prenant une oeuvre aussi baroque que Dune, Denis Villeneuve livre un film totalement formaliste, voir formaté pour être décliné en d’autres produits (une série étant déjà dans les cartons si cela fonctionne).
De la même manière qu’en 2017 il avait repris Blade Runner en dévitalisant totalement l’univers dans l’insipide Blade Runner 2049.
Mais il n’est pas le seul et s’inscrit dans le sillage d’autres réalisateurs de films à gros budgets froids et désincarnés dont Christopher Nolan est probablement le plus grand représentant.
Cette absence, ce refus voir cette incompréhension est justement révélatrice de notre époque et c’est d’un cinéma qui assume la chaleur des sentiments, dans toute leur richesse et complexité, dont nous avons besoin… Ce qui exige un esprit de rupture avec le capitalisme, et de vraies valeurs, comme historiquement le cycle de Fondation d’Asimov en a porté.