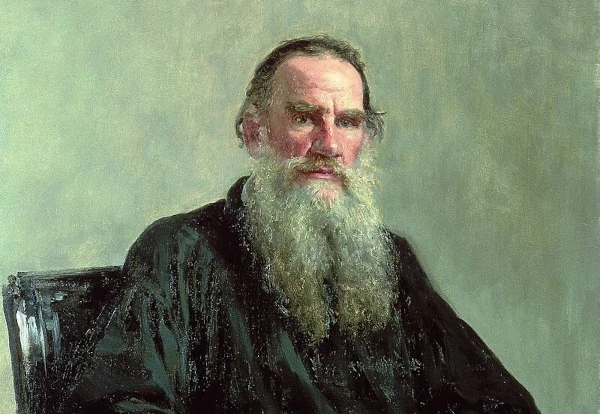Bully v1 est une œuvre époustouflante, une ode soul digne de 2025. Les chansons se combinent, s’emboîtent les unes dans les autres, tout comme chanson emboîte d’autres chansons, formant une mise en abyme permanente, une vague ininterrompue se nourrissant perpétuellement.
Le tout forme une atmosphère mélancolique et rythmée, d’une ampleur envoûtante qui témoigne d’une maîtrise approfondie du processus de création musicale.
L’oeuvre est stupéfiante et a estomaqué les critiques journalistiques : quoi, Kanye West qui est pour nous un nazi, un pro-Trump, est encore capable de produire une œuvre d’une telle dimension ?
C’est qu’ils n’ont pas compris l’attitude punk, autodestructeur authentique de Kanye West, capable de poster sur le réseau social X « J’aime Hitler et maintenant quoi salopes », puis dans la foulée une image de lui tenant une peluche de Hello Kitty dans un ascenseur, en disant que c’est la meilleure chose qu’il pouvait poster maintenant.
Kanye West est cramé, mais cramé comme quelqu’un qui relève du développement inégal, celui de l’artiste qui arrive à maintenir sa productivité envers et contre-tout. Il est aliéné, il le sait, il traverse son aliénation. C’est la position révolutionnaire d’un artiste.
Pourquoi les oiseaux apparaissent-ils soudainement
Chaque fois que tu es près de moi
Parfois je me sens seul, yeah
Je ne me sens pas chez moi tout seul, ouais
Ce n’est pas le même sentiment avec quelqu’un d’autre
Je me sens comme un clone de moi-même, ouais
Je n’ai pas besoin de mentir, plutôt de dire la vérité
Mais je dis la vérité sur tout
Tout, tout, tout
Je n’ai pas d’autre choix que de dire la vérité sur toutParfois, je ne veux tout simplement pas ressentir
Les attitudes, qui apparaissent
Pourquoi je suis encore, ouais, je suis encore
Près de toi, près de toi
Tout ce que nous avons traversé
Qui nous a permis de rester ici ensemble
(Et qui a décidé de réaliser un rêve)
Je l’ai dit une fois, je le redirai encore
Et la lumière dorée des étoiles dans tes yeux
Si vrai, ooh, ooh
Et c’est pourquoiPourquoi les oiseaux apparaissent-ils soudainement ?
Chaque fois que tu es près
Tout comme moi, ils aspirent à être
près de toi
Le jour de ta naissanceLes anges se sont réunis
Et ont décidé de réaliser un rêve
Ils ont saupoudré tes cheveux de poussière de lune
Et c’est pourquoi
Des oiseaux apparaissent soudainement
Chaque fois que tu es près d’eux
Tout comme moi, ils désirent ardemment être
près de toi
Le jour de ta naissance
Les anges se sont réunis
Et ont décidé de réaliser un rêve
Ils ont saupoudré tes cheveux de poussière de lune
Et des étoiles dorées dans tes yeux
Si vrai, ooh, ooh
Et c’est pourquoi…
Pour écrire des paroles ainsi, il faut une réelle profondeur. Écrire ? Justement, non. La première partie et la fin sont reprises à une chanson de 1970 des Carpenters, (They Long to Be) Close to You.
Mais Kanye West n’a pas repris directement la chanson – c’est Kanye West. Il a repris la version chantée par Stevie Wonder. Comme avec Kanye West ce n’est jamais aussi simple, et qu’il faut une mise en abyme, la version de Stevie Wonder est chantée par celui-ci au moyen d’un talkbox, un appareil qui normalement modifie le son d’un instrument en lui faisant imiter la voix humaine.
Pas assez compliqué ? Lors de sa reprise, Stevie Wonder compile la chanson (They Long to Be) Close to You avec Never Can Say Goodbye des Jackson Five !
Nous, nous sommes déjà perdu avec tout cela, Kanye West l’assimile, en produit quelque chose… C’est la matière qui devient matière qui devient matière… Totalement à rebours du fantasme idéaliste de la « création », on est dans la production ininterrompue.
Ajoutons un élément, car avec Kanye West cela n’en finit jamais. On retrouve la chanson des Carpenters, dans film Les Simpsons, dans une scène très précise. Homer est en Alaska, rentre et retrouve une cassette vidéo.
Homer la met dans le magnétoscope et voit Marge lui expliquer qu’elle en a assez, qu’elle prend les enfants et quitte l’Alaska pour ne plus jamais revenir. Tout cela est également pour Kanye West une allusion au conflit avec son ex-femme Kim Kardashian.
Pour renforcer la dimension punk, Kanye West maintient à l’ensemble une dimension distordue, inégale. Il y a un côté cru, sans filtre, comme en témoigne cette chanson finalement pas sur l’album (censé ne pas être encore prêt).
Le titre est You Can’t Hurry Love, reprenant d’ailleurs des paroles de cet immense classique des Supremes, où une femme attend l’amour mais sa mère la prévient : on ne peut pas précipiter les choses (You can’t hurry love / No, you just have to wait / You got to trust, give it time / No matter how long it takes).
Les propos qu’il tient sont on ne peut plus clair. Qui peut dire que ces mots ne parlent pas ?
Nous sommes dans un autre temps pour lequel nous avons été conçus (je ne peux pas supporter de vivre ma vie seule)
Je dois le réarranger, faire avancer mon esprit (Je m’impatiente pour un amour)
Je n’ai pas d’autre choix que d’aller de l’avant (pour appeler les miens)
Il n’y a pas d’autre solution que d’aller à la rencontre de l’autre.
Nous sommes dans un autre temps pour lequel nous avons été conçus
Je dois le réarranger, faire avancer mon esprit
Oh, bouger mon esprit vers l’avant
On notera que deux artistes français ont été samplés également pour deux chansons : d’une part, le groupe de jazz funk, fondé en 1974, Cortex. C’est ici l’album Troupeau bleu qui a été utilisé, une référence pour beaucoup d’acteurs majeurs de la scène hip hop américaine.
Il y a également la chanteuse Pomme, avec la chanson Soleil soleil, très mélancolique, où elle dit notamment « On voudrait tous partir / Retrouver le soleil / Qui nous manque / Qui va brûler toutes nos peines ».
Kanye West a utilisé une partie qui dit « Qui, qui nous hante / Oh, reviens soleil, soleil / Qui, qui nous hante / Oh, reviens » pour l’introduction de Highs and lows, une chanson sur les hauts et les bas (psychologiquement parlant).
Mais Pomme ne veut pas « soutenir l’extrême-droite », comme on le dit si bien du côté des petits-bourgeois français qui s’imaginent contestataires. Alors, elle refuse que Kanye West utilise son sample.
C’est là unilatéral, possessif, tout à fait représentatif. On est dans l’esprit mesquin, le repli sur soi, la contestation de bobo. Le monde réel, pétri de contradictions et d’aspérités, reste à l’écart. Il en résulte une incompréhension fondamentale de la position historique de Kanye West.
Le résumer à un type qui un jour se dit qu’il serait bien sur son site de proposer un t-shirt blanc avec une croix gammée est d’une stupidité complète.
Dans les faits, Kanye West n’est pas pour une société multiculturelle, une société de la séparation. Il est le produit du capitalisme ascendant de la période 1989-2020, où on mixe, on mélange, on assimile, on fusionne, on combine, on copie-colle.
Et, à contre-courant de tout ce qui lui tombe dessus, il maintient le cap, mélangeant, pratiquant le collage, l’ouverture, jusqu’à chanter en espagnol avec une partie chantée par le jeune Mexicain Peso Pluma (reprenant Bésama Mama de Poncho Sanchez : « Embrasse-moi maman, comme tu le sais »).
Chanter ? Une large partie de l’album a des voix réalisés par intelligence artificielle. Rien à voir avec de la fainéantise, évidemment, car on est chez Kanye West, qui travaille le son de manière léchée, calibrée.
Dans ce fourre-tout, Kanye West s’y perd. La belle affaire ! Qui peut en 2025 prendre au sérieux un délire d’un chanteur noir sur une croix gammée nazie ? Au lieu de le dénoncer, Pomme aurait mieux fait de l’aider à rectifier le tir.
Mais ce serait une production et le problème est là : les gens évitent de produire, évitent d’assumer quoi que ce soit. Ils minaudent en permanence, ils sont égoïstes. Kanye West, lui, n’est pas égoïste.
Il se crame dans sa démarche – c’est un artiste, c’est comme cela. Il n’est certainement pas d’extrême-droite pour autant, bien au contraire. Il fait partie de ces artistes, pleins de sensibilité, qui s’égarent. Il n’est pas le premier, il n’est pas le dernier.
Mais son délire est grotesque et ne saurait être pris pour argent comptant. Cela reste punk autodestructeur et donc Pomme a tort, fondamentalement tort.
Kanye West est un immense artiste, il représente la mélancolie et la folie de notre époque. Qui le critique rate que tout est à critiquer dans ce monde où plus rien ne tient debout.
Kanye West n’est pas un immense artiste malgré ses délires pro-Trump ou soit-disant pro-nazi, mais à travers eux : il se fraie un passage dans la folie, il force les choses pour tenir, coûte que coûte. En cela, il est humain, bien plus humain qu’une humanité composée de gens restés en arrière et ayant peur de produire.