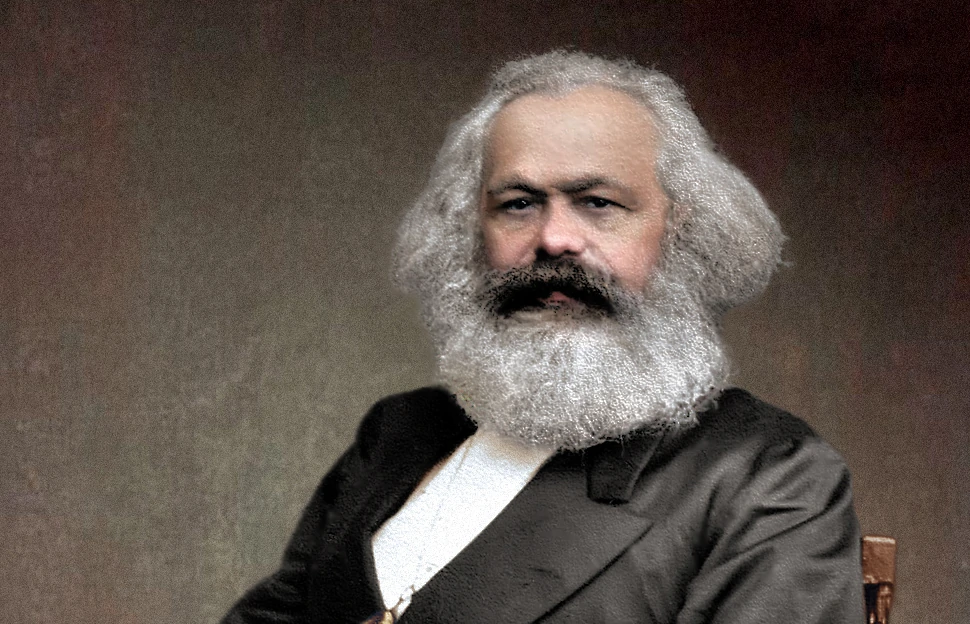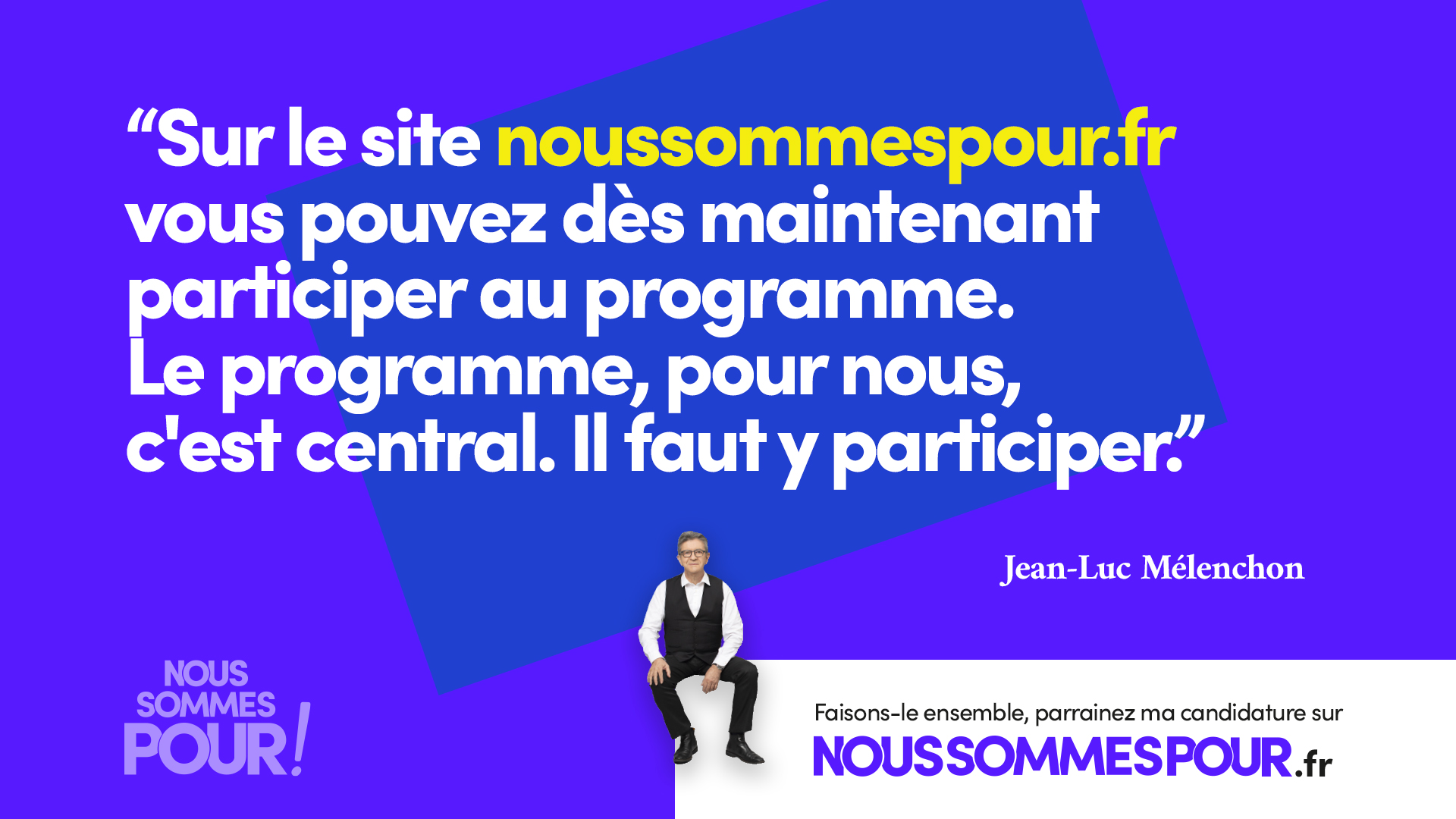Ils ont été adoptés en janvier 2024 au congrès de fondation à Berlin en Allemagne.
« Notre pays ne fait pas bonne figure. Depuis des années, il est gouverné en mettant de côté les souhaits de la majorité.
Au lieu de récompenser les réalisations, il a été redistribué depuis les durs au labeur aux 10 000 d’en haut.
Au lieu d’investir dans un État compétent et de bons services public, les politiciens ont servi les vœux de lobbys influents, et par là vidé les caisses publiques.
Au lieu de prendre soin de la liberté et de la diversité des opinions, un style autoritaire de politique s’est répandu, qui entend dicter aux citoyens comment ils vivent, comment ils se chauffent, comment ils pensent et comment ils parlent.
Beaucoup de décisions politiques semblent prises sans plan d’ensemble, à courte vue et en partie même de manière incompétente.
Sans un redémarrage, notre industrie et notre classe moyenne sont en jeu.
Beaucoup de gens ont perdu confiance en l’État et ne se sentent représentés par aucun des partis existant. Ils ont, à juste titre, l’impression de ne plus vivre dans la République fédérale qui a existé auparavant.
Ils s’inquiètent pour les leurs et l’avenir de leurs enfants. Ils souhaitent une politique responsable de conservation de nos atouts économiques, de compensation sociale et de répartition juste de la prospérité, d’une coexistence pacifique des peuples et d’une préservation des fondements naturels de notre vie.
« L’Alliance Sahra Wagenknecht – Raison et Justice » a été fondée, afin de redonner la parole à ces gens. Nous sommes pour le retour de la raison en politique.
L’Allemagne a besoin d’une économie forte, innovante, et de la justice sociale, de la paix et du commerce équitable, du respect de la liberté individuelle de ses citoyens et d’une culture ouverte de discussion.
Il y a besoin de politiciens fiables, qui se sentent obligés par des objectifs.
Les membres du parti soutiennent les principes et objectifs qui suivent :
Raison économique
Notre pays dispose encore d’une industrie solide et d’une classe moyenne prospère et innovante.
Mais les conditions générales se sont considérablement détériorée ces dernières années. Notre infrastructure publique est dans une situation embarrassante pour un pays industriel leader.
Pratiquement aucun train ne circule à l’heure, en tant que patient de l’assurance maladie obligatoire, on attend des mois pour un rendez-vous avec un médecin spécialiste, il manque des dizaines de milliers d’enseignants, de places en garderie et d’ appartements.
Des rues et des ponts délabrés, des trous dans les réseaux et un internet lent, des administrations débordées et des réglementations inutiles rendent la vie difficile précisément aux plus petites et moyennes entreprises.
Le système scolaire allemand avec 16 différents niveaux d’études, des classes beaucoup trop nombreuses et une sélection anticipée, sabote les chances des enfants de familles moins aisées quant aux opportunités d’éducation et dans la vie, et échoue en même temps à la tâche de former des travailleurs qualifiés dont l’économie a un besoin pressant.
Depuis qu’avec les sanctions russes et la prétendue politique climatique, l’énergie est soudainement également devenue plus chère, ce qui menace notre pays, c’est la perte d’industries importantes et des centaines de milliers d’emplois bien rémunérés.
De nombreuses entreprises envisagent une délocalisation de leur production à l’étranger. D’autres sont menacées dans leur existence même.
La politique, influencée et achetée par les grandes entreprises [les konzerns] et l’échec des autorités antitrust ont créé une économie de marché dans laquelle de nombreux marchés ne fonctionnent plus.
Se sont mises en place de grandes entreprises qui dominent le marché, des monopoles financiers surpuissants comme Blackrock et des monopoles numériques comme Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft et Apple, qui imposent leur tribut aux autres participants du marché, portent atteinte à la compétition et détruisant la démocratie.
Dans une mesure considérable, l’inflation actuelle est également un résultat d’un échec du marché provoqué par un pouvoir économique trop grand.
Nous aspirons à une économie innovante, avec une concurrence loyale, des emplois sûrs et bien payés, une forte proportion de création industrielle de valeur, une fiscalité équitable et une classe moyenne forte.
Pour ça, nous voulons limiter le pouvoir de marché et dégrouper les entreprises dominants le marché.
Là où les monopoles sont inévitables, il faut confier les tâches à des prestataires à but non lucratif.
L’industrie allemande est l’épine dorsale de notre prospérité et doit être conserver. Nous avons de nouveau besoin de davantage de technologies d’avenir made in Germany, plus de champions cachés et non pas moins.
Afin d’empêcher le déclin économique de notre pays, des investissements massifs dans notre système éducatif, notre infrastructure publique et dans des administrations compétentes, sont nécessaires.
Nous avons besoin de fonds futurs pour le soutien des entreprises locales innovantes et des start-up, et non des milliards de subventions pour les monopoles d’outre-Atlantique.
L’Allemagne comme pays fort en exportations et pauvre en matières premières a besoin d’une politique de commerce extérieur fondée sur des relations commerciales stables avec le plus grand nombre de partenaires, au lieu de la formation de nouveaux blocs et de sanctions sans bornes, et qui assure notre approvisionnement en matières premières et en énergie bon marché.
Le changement du climat mondial et la destruction de nos moyens naturels de subsistance sont de sérieux défis, que la politique ne doit pas ignorer.
Cependant, une politique environnementale et de climat sérieuse requiert de l’honnêteté : l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne, eu égard aux technologies d’aujourd’hui, ne saurait être uniquement assurée par les énergies renouvelables.
Un activisme aveugle et des mesures mal pensées n’aident pas le climat, mais mettent en danger notre substance économique, rendent la vie des gens plus chère et minent l’acceptation du public de mesures sensées de protection du climat.
La contribution la plus importante qu’un pays comme l’Allemagne puisse réaliser dans la lutte contre le changement climatique et la destruction de l’environnement est le développement de technologies clés innovantes pour une économie du futur neutre sur le plan du climat et acceptable par la nature.
Justice sociale
Dans notre pays, depuis des années, l’inégalité grandit.
Des millions de personnes travaillent dur, afin de permettre une vie bonne pour eux-mêmes et leurs familles.
Ils sont ceux qui font fonctionner notre société et payent une grande partie des impôts.
Au lieu d’avoir en retour le respect et la protection sociale, leur existence est devenue moins certaine et plus lourde dans les dernières décennies.
Beaucoup de gens, malgré un emploi à temps plein, ne parviennent avec leur revenu pratiquement pas au bout du mois.
La promesse d’avancement de l’économie sociale de marché n’est plus d’actualité, la prospérité personnelle dépend depuis longtemps avant tout du statut social des parents.
La concentration des richesses en Allemagne est aujourd’hui aussi élevé qu’elle l’était avant le début de la Première Guerre mondiale, lorsque le Kaiser régnait encore à Berlin.
Alors que les monopole, même en temps de crise, versent des dividendes records, les files d’attente aux associations caritatives sont de plus en plus longues.
Même ceux qui ont travaillé pendant des années et cotisé pour la sécurité sociale se retrouvent quémandeurs plein d’amertume après une année de chômage.
Parce qu’il n’y a pas de places en garderie et que notre société est tout sauf favorable au cadre familial, les parents célibataires et leurs enfants en particulier vivent souvent dans la pauvreté, qui n’est pas devenue plus supportable par le changement de nom de Hartz IV [réforme de 2005 supprimant des droits sociaux].
Des millions de personnes âgées ne peuvent pas, après une une longue vie professionnelle, profiter de leur retraite, parce que leurs pensions sont abaissées de manière humiliante.
Les appartements, hôpitaux, établissements de soins, cabinets médicaux et bien d’autres d’autres institutions sociales importantes ont été et sont vendus à des chasseurs de rendement
Depuis, les coûts ont augmenté tandis que coule la qualité des services pour la majorité des gens.
Nous voulons stopper la désintégration du vivre-ensemble social et de nouveau aligner la politique sur le bien commun.
Notre objectif est une société méritocratique juste avec de véritables égalité des chances et un niveau élevé de sécurité sociale.
Une économie hautement productive a besoin d’employés qualifiés et motivés. Les conditions préalables pour cela, ce sont des salaires compétitifs, des emplois sûrs et de bonnes conditions de travail.
C’est également vrai pour les salariés des métiers de services, qui sont tout aussi importants pour notre société que les bons ingénieurs et ingénieurs en mécatronique.
Afin d’éviter la pression sur les salaires, la convention collective doit à nouveau être renforcée et la validité générale des conventions collectives être facilitée.
Nous soutenons les employés, leurs syndicats et les comités d’entreprise et du personnel dans leur engagement en faveur des droits des travailleurs et d’un bon travail.
En même temps, notre pays en a besoin un État-providence fiable, qui démonte les peurs de l’avenir et protège de la chute en cas de maladie, de chômage et de vieillesse.
La privatisation et la commercialisation des services existentiels, comme dans les domaines de la santé, des soins ou du logement, doivent cesser ; les prestataires à but non lucratif doivent avoir la priorité sur ces secteurs.
Ce qu’il faut, c’est un système fiscal équitable qui allège le fardeau des faibles revenus et empêche les grandes entreprises et les particuliers très riches de se soustraire à leur juste part du financement de la communauté.
La prospérité personnelle ne doit pas être une question d’origine sociale, mais doit être le résultat d’un travail acharné et d’efforts individuels. Chaque enfant a le droit de voir ses talents découverts et promus.
La paix
Notre politique étrangère se situe dans la tradition du chancelier fédéral Willy Brandt et du président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui ont opposé à la pensée et l’action dans la logique de la guerre froide une politique de détente, d’équilibre des intérêts et de coopération internationale.
La solution des conflits par les moyens militaires, nous la rejetons fondamentalement.
Nous nous opposons à ce que de plus en plus de ressources vont aux armes et aux équipements de guerre, au lieu d’aller à l’éducation de nos enfants, la recherche de technologies protectrices de l’environnement ou aux installations de santé et de soins.
L’armement nucléaire et l’escalade des conflits entre les puissances nucléaires mettent la survie du l’humanité en danger et il faut y mettre fin.
Nous luttons pour une nouvelle ère de détente, et de nouveaux contrats de désarmement et de sécurité commune.
La Bundeswehr [l’armée allemande] a pour mission de protéger notre pays. Pour cette tâche, elle doit être adéquatement équipée.
Nous refusons le déploiement de soldats allemands dans les guerres internationales, tout comme leur stationnement à la frontière russe ou en mer de Chine méridionale.
Une alliance militaire, dont la puissance dominante a ces dernières années attaqué cinq pays en violation du droit international, avec plus d’un million de personnes tués dans ces guerres, alimente les sentiments de menace et les réactions de défense et contribue ainsi à l’instabilité générale.
Au lieu d’un instrument de pouvoir pour des objectifs géopolitiques, nous avons besoin d’une union de défense alignée de manière défensive, qui respecte les principes de la Charte des Nations unies, vise au désarmement au lieu de s’engager dans la course aux armements, et dans laquelle les membres sont sur un pied d’égalité.
L’Europe a besoin d’une architecture de sécurité stable qui, à long terme, devrait aussi inclure la Russie.
Notre pays mérite un politique sûre d’elle-même, qui place l’accent sur le bien-être de ses citoyens et qui soit porté par la considération que les intérêts américains diffèrent parfois grandement des nôtres.
Notre objectif est un Europe indépendante des démocraties souveraines dans un monde multipolaire, et non pas une nouvelle confrontation des blocs, dans laquelle l’Europe se retrouve comprimée entre les États-Unis et un bloc en formation prenant toujours plus conscience de lui-même, autour de la Chine et de la Russie.
La liberté
Nous voulons redonner souffle à une formation démocratique des vœux, élargir le processus décisionnel démocratique et protéger la liberté personnelle.
Nous rejetons les idéologies extrémistes de droite, racistes et promptes à la violence.
La Cancel Culture, la pression à la conformité et le rétrécissement croissant de l’éventail d’opinions sont incompatibles avec les principes d’une société libre.
Il en va de même pour le nouvel autoritarisme politique, qui prétend éduquer les gens et réglementer leur mode de vie ou leur langage.
Nous condamnons les tentatives de surveillance générale et de manipulation des gens par les monopoles, services secrets et gouvernements.
L’immigration et la coexistence de différentes cultures peuvent être un enrichissement. Mais cela ne s’applique que tant que l’afflux est limité à un certain ordre de grandeur, ne déborde pas notre pays et ses infrastructures, et tant que l’intégration est activement promu et réussit.
Nous le savons : le prix d’une concurrence accrue pour des logements abordables, des emplois à bas salaires et pour une intégration ratée sont payés en premier lieu par ceux qui n’ont pas leur place au soleil.
Toute personne politiquement persécutée dans son pays a droit à l’asile.
Mais la migration n’est pas la solution au problème de la pauvreté dans notre monde.
Au lieu de cela, nous avons besoin des relations économiques mondiales équitables et une politique qui s’efforce de produire davantage de perspectives dans les pays d’origine.
Une société dont les acteurs les plus puissants ne sont motivés qu’à gagner plus d’argent au moyen de l’argent conduit à des inégalités croissantes, jusqu’à la destruction nos ressources naturelles et à la guerre.
Nous y opposons nos idées de sens commun, de responsabilité et de vivre-ensemble, à qui nous souhaitons redonner une chance par la modification des rapports de force.
Notre objectif est une société dans laquelle le bien commun est supérieur aux intérêts égoïstes, où ce ne sont pas les tricheurs et les joueurs qui gagnent, mais ceux qui réalisent un travail honnête et bon, sincère et solide.