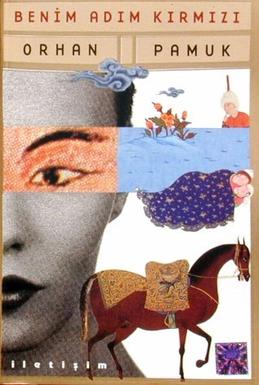Ready player one est un film basé sur un roman du même nom sorti en 2011, et réalisé par Steven Spielberg. Le film est sorti le 28 mars 2018 en France et a reçu d’excellentes critiques.
Ce qui est conforme à l’esprit d’une époque marquée par la régression et l’infantilisme, la fuite dans l’artificiel et le virtuel.
Posons le cadre. L’action se déroule aux États-Unis en 2045 dans la ville de Columbus, dans l’Ohio. Le monde est en déclin suite à diverses crises, les villes sont surpeuplées, et tout le monde préfère se réfugier dans une réalité virtuelle : l’OASIS. Ce monde est un jeu développé par un personnage présenté comme un rêveur et un utopiste introverti fan de « culture pop », James Halliday. Dans l’OASIS tout serait possible, les seules limites seraient l’imagination de chacun…
 Chacun accumule de l’argent et des objets, chacun peut accumuler et dépenser tout son argent jusqu’à ce que son personnage meurt. Comme dans de nombreux jeux vidéos, le personnage ressuscite… mais il perd tout ce qu’il a accumulé jusque là.
Chacun accumule de l’argent et des objets, chacun peut accumuler et dépenser tout son argent jusqu’à ce que son personnage meurt. Comme dans de nombreux jeux vidéos, le personnage ressuscite… mais il perd tout ce qu’il a accumulé jusque là.
En 2045, Halliday est déjà mort. Il a laissé un quête dont le prix est le contrôle de l’OASIS. La société IOI, toute puissante dans le monde réel, ne rêve que d’une chose : en prendre le contrôle afin de dégager des profits colossaux : publicités ciblées, annonces en tout genre, etc. Quelques jeunes vont s’y opposer… Évidemment avec succès.

Dès le départ le contexte est tout simplement grossier : un libéral-libertaire rêveur et mégalo (il faut connaître tous les détails de la vie d’Halliday pour réussir la quête), son jeu délirant où règne une sorte de capitalisme pré-monopolistique et relativement pacifié d’un côté, et une caricature de réalité avec de méchante entreprises de l’autre. Les bons et les mauvais. Les gentils rêveurs en jean baskets et les méchants en costumes cravates.
Cela a l’air de gauche, mais c’est du populisme, le plus outrancier.
Tout au long des deux heures du film, s’enchaînent alors des références à la dite « pop culture » sans aucun esprit de synthèse, sans aucune recherche. La « pop culture » en question semble d’ailleurs se résumer surtout aux années 1980. Les quadras sont ravis, leur vie semble avoir un sens, la vanité de leur vie sociale avoir trouvé un masque de culture.
 Mais si le film s’était contenté de n’avoir aucune profondeur, on pourrait le considérer comme un énième divertissement très bien réalisé graphiquement, rempli de références, mais surtout sans aucun intérêt, un énième film plat et infantilisant dans sa fascination pour les jeux vidéos et les super héros.
Mais si le film s’était contenté de n’avoir aucune profondeur, on pourrait le considérer comme un énième divertissement très bien réalisé graphiquement, rempli de références, mais surtout sans aucun intérêt, un énième film plat et infantilisant dans sa fascination pour les jeux vidéos et les super héros.
Seulement, il y a un détail qui révèle le caractère fondamentalement réactionnaire de ce film.
Qu’un film fantasme sur un mode virtuel, les premiers easter eggs dans les jeux vidéos, Godzilla, Star wars, Terminator, Retour vers le futur, Aha, Duran Duran, etc. pourquoi pas. Qu’une grosse production hollywoodienne sort encore une pseudo-critique des méchants dirigeants en costumes et sans émotions, ce n’est pas une surprise.
Mais qu’un film aussi niais et mauvais se serve de Joy Division comme caution alternative, ou encore de la fameuse chanson des Twisted Sisters, ou encore d’un look punk, alors là il faut dire non.

Car pourquoi la scène de la tentative d’arrestation a-t-elle comme point culminant la vision de la femme avec le t-shirt ayant la pochette d’Unknown pleasures, le premier album de Joy Division ?
Pourquoi la grande offensive a-t-elle lieu sur les Twisted Sisters, avec leur chanson de véritable confrontation à l’idéologie dominante ?
Tout simplement parce que le film a besoin d’une caution rebelle. Sauf que la rébellion n’est pas une composante d’une pop culture réduite à une accumulation d’anecdotes !
Ecouter Joy Division, les Twisted Sisters, cela avait un prix : celui de l’engagement contre un abrutissement dominant, contre la domination d’une consommation de masse allant dans le sens de l’aliénation au lieu du progrès culturel et de l’approfondissement de nos facultés.
C’était une rébellion, en tant qu’expression de la soif existentielle pour un autre monde.
Ready player one ne vaut ici pas mieux que les marques de skate qui se sont vendus à des grands groupes et vendent leurs produits sous une imagerie faussement rebelle. C’est un éloge de la fuite dans le virtuel, de l’esprit de clan pour s’en sortir.
C’est un parfait exemple de récupération du romantisme, de la rébellion, par le capitalisme, pour s’octroyer une apparence de sens, et ici appuyer un film sans aucune profondeur, sans aucune esthétique, sans aucune identité propre, où tout est fade, simple et niais.
Le capitalisme ne peut que pervertir la pop culture authentique, les véritables valeurs culturelles!