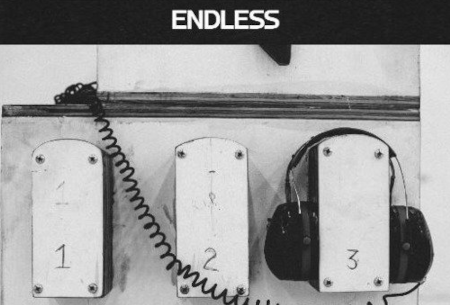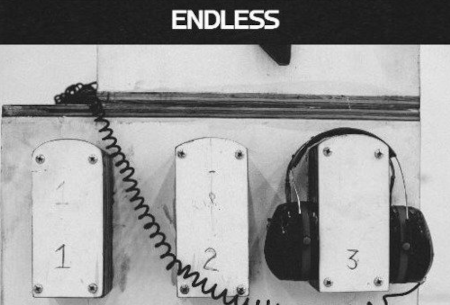L’acteur écossais Sean Connery est décédé dimanche 1er novembre 2020 à l’âge de 90 ans. Il a été très tôt célèbre pour avoir interprété James Bond durant les cinq premiers films de la franchise. Il est aussi très connu pour son rôle de père d’Indiana Jones ou celui d’officier de police « incorruptible » dans le film du même nom de Brian De Palma. Voici un retour sur quelques-uns de ces films les plus marquants.
La filmographie de Sean Connery est extrêmement riche mais sa partie la plus intéressante est probablement celle des années 1960 et 1970, qui s’est faite en parallèle de ses rôles de super espion.
En 1965, il joue pour la première fois sous la direction de Sidney Lumet dans La Colline des hommes perdus. À cette époque, Sidney Lumet n’a pas encore réalisé ses films les plus célèbres mais s’est déjà fait un nom de réalisateur progressiste, notamment avec le fabuleux 12 hommes en colère, ôde à la justice et à la démocratie et où il fait la démonstration qu’une réalisation n’a pas besoin de multiplier les effets de caméra pour déborder d’intensité.
La Colline des hommes perdus est un excellent film dont le projet est d’ailleurs porté par Sean Connery. On y suit cinq détenus d’un camp militaire disciplinaire anglais durant la seconde guerre mondiale, s’attaquant au despotisme des petits chefs, à l’absurdité des ordres dans l’armée, à sa violence pour briser mentalement les individus.
Le titre vient de la colline de sable que doivent escalader encore et encore les détenus dès que leur sergent le décide, sous le soleil libyen.
La charge contre une discipline de la peur et de l’humiliation, n’ayant aucun sens, faisant fi de toute morale, dépasse assez clairement le cadre de l’armée que l’on finit par oublier, emporté par la mise en scène de Sidney Lumet qui change au cours du film de focale pour se rapprocher toujours plus des visages déformés par la peur et la colère devant l’injustice.
Il s’agit de la première des cinq collaborations entre Sean Connery et Sydney Lumet dont la plus célèbre est probablement le très noir The Offence sorti en 1973, certainement la meilleure prestation de l’acteur écossais.
Cinq ans après La colline des hommes perdus, on le retrouve dans un autre film tout aussi passionnant : Traître sur commande, de Martin Ritt.
Martin Ritt est un réalisateur américain assez méconnu aujourd’hui, qui a pourtant réalisé de grands films, souvent marqués par un cinéma ouvertement engagé, dans des genres aussi variés et populaires à l’époque que le western (Hombre, 1967), le drame aux accents de film noir (L’homme qui tua la peur, 1956), ou le film d’espionnage (L’Espion qui venait du froid, 1965).
Avec Traître sur commande (The Molly Maguires), il prend pour base une histoire inspirée de faits réels, celle du groupe secret des Molly Maguires qui dans les 1870, face à la répression des organisations syndicales dans les mines de charbon de Pennsylvanie, menèrent plusieurs actions de sabotages et d’agressions.
Ainsi le film prend place au sein d’une communauté d’émigrés irlandais vivant dans une ville des plus austères, comme sortie de terre uniquement pour l’exploitation de la mine de charbon. Austérité renforcée par une photographie volontairement terne, et les nombreuses séquences dans la quasi-obscurité étouffante de la mine.
L’enjeu du film repose sur l’infiltration d’un agent de police (interprété par Richard Harris) au sein des travailleurs de la mine, avec pour but le démantèlement et l’arrestation des têtes des Molly Maguires.
Si Martin Ritt ne laisse qu’assez peu de doute sur son parti-pris dans le récit, l’intérêt du film va bien plus loin et est multiple.
Il a tout d’abord une approche très réaliste, quasi-documentaire de la vie de ces mineurs, de leur travail. Ainsi le film s’ouvre sur une longue séquence où l’on suit les hommes descendre à la mine, dans un travail difficile et dangereux. Pas une parole n’est prononcée pendant près d’un quart d’heure et pourtant le cinéaste nous a déjà embarqués avec lui.
On peut d’ailleurs noter qu’outre Richard Harris, la vraie tête d’affiche du film est bien Sean Connery, et pourtant sa première ligne de dialogue n’arrive qu’assez tardivement.
La recherche de la justice est une nouvelle fois au cœur du film, ainsi que le questionnement moral du personnage de Richard Harris, mais aussi de la femme du village minier avec laquelle il va nouer une relation.
Comme chez Sidney Lumet, la radicalité du film, dans son propos et dans sa mise en scène, tranche nettement avec les gros rôles de Sean Connery à l’époque.
Il dira d’ailleurs bien plus tard que Traître sur commande et La colline des hommes perdus font partie des films dont il est le plus fier.
En 1974 sort probablement la plus grande bizarrerie de la filmographie de l’écossais : Zardoz, de John Boorman.
Le film est extrêmement connu pour le look de son acteur principal, improbable avec ses bottes qui remontent à mi-cuisse, son slip rouge assorti à ses cartouchières en guise de bretelle, la moustache et le catogan.
Le film fait effectivement assez cheap, mais c’est un peu court pour le classer dans la catégorie des « nanar sans intérêt ».
S’il joue souvent l’équilibriste, jamais bien loin de tomber dans le grotesque et le mauvais goût, dont on pourrait considérer qu’il franchit parfois la limite, John Boorman livre une fable philosophique qui n’en demeure pas moins intéressante.
Le film s’inscrit dans la lignée de films produits par les gros studios hollywoodiens se rattachant à la contre-culture, comme par exemple les très bons Silent Running de Douglas Trumbull (1972) et Soleil Vert de Richard Fleischer (1973), deux violentes charges écologiques.
Dans Zardoz la population humaine est divisé entre « Les Éternels », qui ont réussi à atteindre l’immortalité et se sont construits un territoire préservé et imprenable, et « Les Brutes », vivant dans un monde ravagé par la violence et la barbarie, et fournissant de la nourriture aux Éternels.
Entre les deux se tient le « Dieu » Zardoz, prenant l’apparence d’un immense visage de pierre, flottant dans les airs et flattant les bas instincts des Brutes, leur fournissant des armes, les poussant à s’entre-tuer et les maintenant dans un état de barbarie.
Dès le début du film, on sait que ce Dieu n’est qu’une supercherie.
On découvrira aussi rapidement que la vie des Éternels, dont la représentation fait volontairement penser à des hippies, n’est pas si enviable, la disparition de la mort leur ayant retiré une part d’humanité, retirant finalement toute vie de leur monde.
Le film n’est pas exempt d’ambiguïtés, car on y sent une défiance à l’égard du collectif et du communisme dans la représentation des Éternels, mais dans le même temps le libre arbitre se retrouve mis en cause par une révélation vers la fin du film.
Pour terminer nous pouvons également citer L’homme qui voulut être roi, un savant mélange de film d’aventure et de comédie grinçante, mis en scène par John Huston (1975), qui prolonge les thématiques du pouvoir et de la religion puisque Sean Connery y incarne un franc-maçon aventurier qui parviendra à devenir roi d’un pays par la guerre et la superstition, et dont l’esprit navigue entre avidité, quête de pouvoir, et absurdité de sa propre condition.












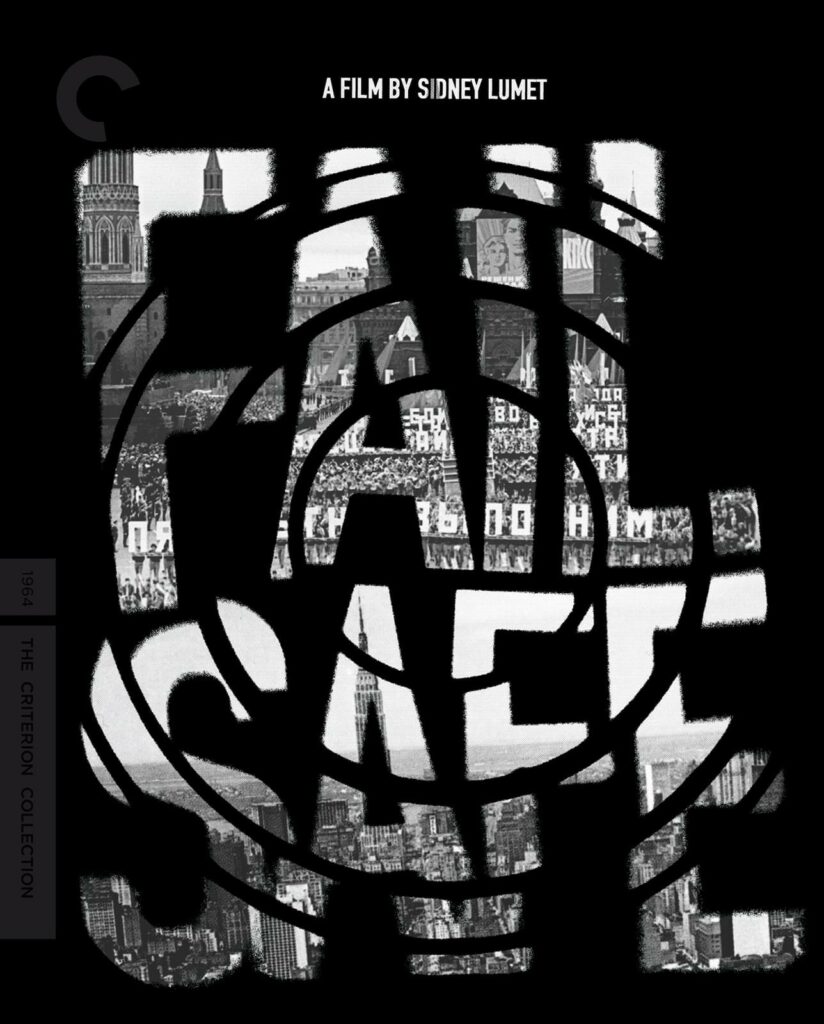











































 Ce qui est ici très intéressant, c’est que Puma va directement dans la voie de la socialisation. Puma, ce n’est pas une marque de sport, ni même de streetwear stylé. C’est une esthétique, exactement comme dans le Socialisme il y aura de multiples esthétiques proposés qu’on pourra trouver pour s’épanouir. Puma, c’est déjà des robes, des maillots de bains, des soutiens-gorges, des sous-vêtements, des leggings, des chaussettes, des polos, des sacs à dos, des lunettes de soleil, des casquettes, des montres, des pantalons, des gants, des bonnets, etc. etc.
Ce qui est ici très intéressant, c’est que Puma va directement dans la voie de la socialisation. Puma, ce n’est pas une marque de sport, ni même de streetwear stylé. C’est une esthétique, exactement comme dans le Socialisme il y aura de multiples esthétiques proposés qu’on pourra trouver pour s’épanouir. Puma, c’est déjà des robes, des maillots de bains, des soutiens-gorges, des sous-vêtements, des leggings, des chaussettes, des polos, des sacs à dos, des lunettes de soleil, des casquettes, des montres, des pantalons, des gants, des bonnets, etc. etc.